Merci à l'auteur, membre du Collectif de Soutien NDDL66, pour cette compilation mensuelle précieuse.
PROJET D’AYRAULT – PORT de
NOTRE DAME DES LANDES (44)
Source : ZAD.nadir.org et médias
Juillet 2017
Et ailleurs : A45 (42-69) - LGV Sud Bordeaux (33) - Bure (55) - #NO G20 à Hambourg (Allemagne) - GCO à Strasbourg (67) - Val Tolosa (31) - Forêt de Hambach (Allemagne) - Ligne Lyon-Turin (73) - Europacity (95) -
Mort de Vital Michalon à Creys Malville (38) le 31-07-1977
ZAD
de NDDL - 44
Infos du 1er au 9 juillet
►AntiRep
Sortie par la porte (le conseil constitutionnel l’avait censurée en juin), l’interdiction de manifester revient par la fenêtre dans le volet "état d’urgence permanent", afin de mieux imposer la casse sociale par ordonnance et tenter de museler la rue. Mmmmhhh la fRance état-de-droit, partie-des-droits-de-l’homme blablabla, c’est de plus en plus …. frappant… Un article ici.
Résister, agir, vivre :
rassemblement à Notre-Dame-des-Landes
les 8 et 9 juillet
Il
reste cinq mois aux trois médiateurs nommés par le Premier
ministre, pour trouver une issue au projet controversé de transfert
de l’aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes.
Alors que la déclaration d’utilité publique arrive à son terme
en février prochain, la coordination des opposants au nouvel
aéroport appelle à un large rassemblement les 8 et 9 juillet. Pour
cette édition 2017, la lutte contre EuropaCity, un grand projet
contesté en Île-de-France, sera mise à l’honneur. Voici l’appel
de la « Coordination des opposants ».
« À
nouveau, la Coordination des opposants [1]
nous invite, habitants, voisins, collectifs de lutte, organisations
locales... et bien au-delà, à nous rassembler ici, à
Notre-Dame-des-Landes contre le projet d’aéroport. Nous avons
besoin de ce moment fédérateur et convivial, expression et
instrument d’une mobilisation intacte.
Réaffirmée
le 8 octobre 2016 lors du « serment des bâtons », notre
base demeure la défense de nos terres agricoles, des paysans et
habitants menacés d’expulsion, et celle de ce territoire :
nous nous y sommes préparés activement cet automne, tout en
poursuivant les actions politiques, juridiques et d’information des
citoyens.
Notre
lutte locale participe, avec beaucoup d’autres, à la recherche
d’un mieux vivre général, solidaire, pour tous les peuples de
notre Terre. Nos préoccupations précédentes demeurent
(réchauffement climatique, démocratie...).
Résister, agir, vivre
D’ici
et d’ailleurs, retrouvons-nous ces 8 et 9 juillet. Quelles que
soient les issues du long tunnel électoral 2017, et les nouvelles
décisions gouvernementales qui s’ensuivront, sur le sujet de
Notre-Dame-des-Landes, nous maintiendrons nos positions : non au
projet d’aéroport ! Résistance ! »
La
Coordination des opposants sur Bastamag
* toutes les infos pratiques et les programmes sont sur http://www.notredamedeslandes2017.org/
* Radio klaxon sera dans la place aussi ! "
on sort du bus et on bouge sur le site du "festival" samedi 8 juillet !! Le studio mobile va émettre en direct à partir de 12h30 jusqu’à 20h, toutes les personnes qui ont envie peuvent venir causer dans le micro et aussi se poser pour écouter la radio, poser du son*... Si y a des zinfos à faire passer ce sera aussi un bon moyen de communiquer sur le site. Alors branche - toi sur 107.7 fm et pour communiquer avec nous y a aussi le téléfon : 0753380670
*comme
d’hab les propos sexistes, racistes, homophobes, transphobes,
validistes, classistes ne sont pas les bienvenus
* Les
rencontres intercomités
auront lieu en 2 temps sous le chapiteau n°7 :
le samedi 8
de 13h à 14h50
le dimanche 9 de 16h30 à 17h50
le dimanche 9 de 16h30 à 17h50
* et voilà un petit récapitulatif des discussions en lien avec les dynamiques de luttes syndicales à l’invitation du collectif syndical contre l’aéroport et son monde.
Samedi 13h sous le chapiteau COPAIN, une discussion pour les syndiqués et travailleurs : comment lutter contre l’aéroport depuis nos positions isolées ou collectives.
Dimanche
10h chapiteau COPAIN : COORDINATION Front social régionale
13h :
pour préparer la rentrée, quelles convergences entre luttes
sociales et environnementales, entre ouvrier et paysans, autonomes et
syndiqués...
* et
plein d’autres rdv à découvrir sur place.
Notre-Dame-des-Landes: les méthodes innovantes de la médiation
Les médiateurs
nommés par le gouvernement organisent des réunions d’examen de
controverse pour démêler l’écheveau de décennies de batailles
pour et contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants se
rassemblent ce week-end à côté de la ZAD.
Un grand projet
peut en chasser d’autres. En inaugurant les nouvelles lignes
ferroviaires à grande vitesse vers Rennes et Bordeaux le 1er
juillet, Emmanuel Macron a surpris en déclarant que « la
réponse aux défis de notre territoire n’est pas aujourd'hui
d'aller promettre des TGV ou des aéroports de proximité à tous les
chefs-lieux de département de France ». Aucun nom
d’infrastructure n’a été cité mais les opposants et partisans
du projet d’aérogare le plus célèbre de France, celui de
Notre-Dame-des-Landes, s’interrogent depuis sur la portée de la
phrase présidentielle. Pour l’atelier citoyen, un collectif de
contre-expertise favorable à la rénovation de l’actuel aéroport,
avec quarante-cinq minutes gagnées sur le trajet Paris-Rennes et
quinze minutes sur le Paris-Nantes : « L’aéroport
NDDL devient de plus en plus inutile. »
 |
|
Lors
du rassemblement des opposants à l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, juillet 2016 (JL)
|
Début juin, trois personnalités ont été nommées pour conduire cette mission sensible : Anne Boquet, ancienne préfète de la région Bourgogne, Michel Badré, ancien président de la formation environnementale du CGEDD, un groupe d’experts qui conseille le gouvernement, et Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne, président d’honneur de l’Aéro-club de France, et proche de Nicolas Hulot. Ces deux derniers sont accusés de biais partisans anti-Notre-Dame-des-Landes par des militants pro-aéroport.
Selon
leur lettre de mission :
« Toutes
les solutions devront être envisagées dans le sens de l’intérêtgénéral, avec la préoccupation d’apaiser l’ensemble des
acteurs et de rétablir l’ordre public. »
Pour
y parvenir, les médiateurs reçoivent tous celles et ceux qui le
souhaitent et programment des « réunions d’examen de
controverse » sur les sujets techniques clivants : les
contours du plan d’exposition au bruit nantais, les prévisions de
trafic, l’évolution technique de la flotte… Les experts de
l’atelier citoyen ont ainsi pu confronter leurs estimations avec
les spécialistes de la direction générale de l’aviation civile.
Si les désaccords persistent, des experts extérieurs pourraient
être sollicités et de nouvelles études commandées. Pour Françoise
Verchère, coprésidente du CéDpa, collectif des élus contre
l’aéroport, « la démarche est bonne. C’est la première
fois que nos travaux sont vraiment pris au sérieux. Cela permet de
travailler ».
Les
associations gardent un mauvais souvenir de la
Commission nationale du débat public, chargée d’élaborer le
dossier d’information des électeurs avant la consultation de
2016. Leurs arguments n’avaient pas été repris à égalité avec
ceux des pro-aéroport. Les travaux de la Direction générale de
l'aviation civile (DGAC) avaient nourri le document alors que
l’atelier citoyen n’avait pas pu être auditionné. En 2013, à
l’issue de la Commission de dialogue nommée par Jean-Marc Ayrault,
un groupe de travail avait planché sur les problèmes de bruit. « La
Dgac et nous avons posé chacun nos points de vue, puis le préfet a
dit que c’était fini. Et il ne s’est plus rien passé »,
se souvient Geneviève Lebouteux du CéDpa. Cette fois-ci, « il
y a beaucoup plus de confiance mais nous avons des interrogations :
qui seront les experts sollicités ? Quel sera leur niveau
d’indépendance ? ».
L’Acipa, association historique des opposants à l’aéroport,
reçue également, aimerait plus de transparence sur la liste des
personnes auditionnées et des thèmes traités. Et propose que les
auditions soient filmées et mises en ligne, comme pour la commission
parlementaire sur les mesures compensatoires.
« Tout faire pour éviter un nouveau Sivens »
Pour
une participante, « à la différence de ce qui se passe
habituellement, des rencontres officieuses de cabinet, on formalise
ici un processus où les contradictions sont reconnues, à la fois
sur les dimensions techniques du dossier mais aussi la
hiérarchisation des valeurs qu’il implique. Tout le monde ne
partage pas la même vision de la société. Si on pose les bonnes
questions, les bons projets résistent et les mauvais chancellent ».
Sollicité par Mediapart, le secrétariat général de la médiation
nous a répondu « s’attacher à rencontrer et écouter
toutes les parties en présence », mais ne pas juger
opportun de communiquer sur son travail. Un point d’étape est
prévu à mi-parcours pour s’exprimer publiquement.
Certains
demandent à être reçus, comme Jean-Claude Lemasson, le maire de
Saint-Aignan-de-Grandlieu, commune mitoyenne de l’actuel aéroport :
« C’est un processus de plus mais il y a une forme de
sincérité que je reconnais. » Il les a accueillis dans sa
commune et leur a notamment parlé de l’impact des nuisances
sonores sur la santé des habitants. D’autres reçoivent un appel
du sous-préfet en charge du dossier de l’aéroport, Stéphan de
Ribou, comme le président des Ailes pour l’Ouest, Alain Mustière.
Et
il y a ceux qui refusent d’emblée d’y participer, comme les élus
du Syndicat mixte aéroportuaire (SMA), qui se sont contentés de
transmettre des éléments techniques sur des aspects juridiques et
environnementaux du dossier. Seule la maire de Nantes, Johanna
Rolland, a reçu les médiateurs, par courtoisie républicaine mais
sans fournir une contribution en bonne et due forme, précise son
entourage. Le président de la région Pays-de-la-Loire, Bruno
Retailleau (LR), leur ferme aussi sa porte. Pour ces responsables
locaux, les citoyens consultés l’année dernière ont voté oui à
l’aéroport, la justice a jusqu’ici rejeté tous les recours des
opposants et l’Europe a classé sans suite la procédure
d’infraction. Ils ne voient pas quel serait leur intérêt à
débattre des alternatives à un projet acté juridiquement et
démocratiquement, à leurs yeux.
Président
des Ailes pour l’Ouest, pro-aéroport, Alain Mustière considère
qu’« on perd du temps avec ce processus, car les débats
sont clos » mais « c’est la méthode Macron :
il y a des arguments des deux côtés et à la fin il faut
trancher ». Il a rencontré les médiateurs pour leur
parler des nuisances que causerait un développement de Nantes
Atlantique, l’actuel aéroport, pour la population nantaise
croissante ainsi que la faune et la flore de la zone Natura 2000
toute proche. Le devenir de la ZAD n’est pas dans le périmètre de
la mission. Les médiateurs n’ont pas pris contact avec ses
occupant.es qui, de leur côté, ont décidé de ne pas leur
répondre, par refus d’un processus de neutralisation et de
dépolitisation des enjeux, considèrent-ils. Pour un.e
participant.e, « on est dans un processus qui reste fragile.
On est en train de démêler un écheveau après des années de
questions sans réponse et de contradictions. Ce n’est pas une
reprise à zéro de la discussion. Il faut que les sujets clivants et
les angles morts soient mis sur la table ».
Des
réunions doivent avoir lieu pendant tout l’été, ce qui
représente une forte charge de travail pour les collectifs et
associations animés par des bénévoles. Le souvenir de la mort du
jeune militant Rémi Fraisse, tué par un gendarme en 2014 sur la Zad
occupée pour protester contre le barrage de Sivens, hante les
esprits. « Tout faire pour éviter un nouveau Sivens »,
confie un participant. Mais le calendrier est très court. Les
médiateurs doivent rendre leur rapport le 1er décembre.
Jade
Lindgaard –
Médiapart
Infos du 10 au 16 juillet
►Le
rassemblement d’été de la coordination a rassemblé une vigntaine
de milliers de personnes ce week-end (selon la presse) malgré la
chaleur pour de nombreuses discussions.
Le rassemblement de Notre-Dame-des-Landes
projette la Zad dans l’avenir
Bonne
humeur et chaleur pour le rassemblement qui s’est tenu les 8 et
9 juillet sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes. Alors que
l’abandon du projet d’aéroport devient crédible, le mouvement
s’organise pour pérenniser la Zad comme un lieu paysan et
solidaire.
Notre-Dame-des-Landes
(Loire-Atlantique), reportage
Le
17e rendez-vous estival des opposants au projet d’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes s’est tenu sur le site samedi 8 et dimanche
9 juillet, sous la canicule. Principale question courant dans ce
rassemblement joyeux et détendu : qu’adviendrait-il de la Zad
(zone à défendre) en cas d’abandon du projet - de plus en plus
crédible ? Quel rapport de force possible pour que l’évacuation
ne suive pas une annonce officielle de renoncement au projet ?
La
médiation engagée par le gouvernement laisse présager une
issue favorable sur le seul dossier de l’aéroport. Mais beaucoup
se rappellent que c’est la nième instance de « dialogue »
instaurée
par un gouvernement, et qu’il convient de ne pas faire une
confiance aveugle à cette configuration : Nicolas Hulot au
gouvernement, deux des trois médiateurs plutôt opposés au projet,
et la nouvelle force politique En Marche dont certains élus se sont
déclarés contre cet aéroport parachuté en plein bocage.
« Il
y a la troisième du trio de médiateurs, la préfète [Anne
Boquet, ndlr] qui ne dit apparemment pas grand chose et qui, avec
le rapporteur, pourrait être les antennes de Macron pour jauger le
rapport de forces en cas d’évacuation de la Zad »,
remarque un zadiste.
« Les
deux enjeux du début de mandat de Macron, c’est de réussir à
passer sa réforme bulldozer du code du travail et à gérer l’avenir
de la Zad. L’aéroport, c’est un enjeu qui ne les intéresse pas
au premier plan, mais c’est un gouvernement d’ordre, et cette
zone qui expérimente en bafouant le capitalisme, ça n’est pas
supportable pour des gens comme eux. Si Macron réussit à passer ces
deux obstacles, il aura le champ libre pour tout le reste... »
analyse
un barbu en s’épongeant le front. « Si
la Zad était évacuée, ce serait très mauvais pour nous
syndicalistes, et si les syndicalistes se font écraser, c’est
aussi mauvais pour la Zad »,
résume Francis
Lemasson, secrétaire de la CGT Vinci.
Les
médiateurs ont reçu une délégation de l’union départementale
CGT, de la Confédération paysanne, et du CeDpa (collectif d’élus
opposants à l’aéroport). Les cégétistes présents ce week-end
lors du rassemblement ne connaissaient pas encore la teneur des
échanges avec les dirigeants nantais de leur syndicat. Le syndicat
paysan et le collectif d’élus se sont eux déclarés satisfaits
quant à la qualité de l’« écoute attentive »
des médiateurs dont l’approche « distingue les faits des
opinions », tout en menant des « réunions
contradictoires » entre partisans et opposants au projet.
Dans
un bocage où les paysans bataillent depuis 1972 contre ce projet
d’aéroport, le porte parole de la coordination des opposants,
Dominique Fresneau, a commenté l’issue possible de la médiation :
« Que le résultat soit favorable ou pas, la lutte n’est
pas terminée. Si en décembre, ils décident d’abandonner le
projet et d’évacuer la ZAD, il faudra continuer à lutter ici. »
Tous zadistes, tous résistants
Sur
les deux jours, le rendez vous a rassemblé quelques plus de 20.000
personnes, selon les organisateurs. Zadistes et associations plus
citoyennistes l’ont donc réaffirmé : la lutte ne
s’arrêterait pas avec l’abrogation de la déclaration d’utilité
publique. Les liens tissés entre les opposants déjà sur place
avant 2009 et celles et ceux qu’on appelait « squatteurs »,
« jeunes » puis « zadistes » sont
forts de ces années de discussions, d’entraide et d’amitiés,
même émaillées de prises de bec, d’actions concertées.
Pour
avoir un coup d’avance, certains imaginent de reprendre vite
d’autres terres en friche dans le périmètre de la Zad, et de les
remettre en culture, pour réaffirmer la détermination à rester
avec des pratiques agricoles diverses, sur des terres partagées,
privilégiant l’usage aux droits ancestraux liés à la propriété
foncière. La stratégie zadiste, dont le terme englobe désormais
les paysans historiques, expulsables comme les autres depuis janvier
2016, c’est d’occuper le terrain, au sens propre comme au figuré.
Dans
ce champ à l’herbe jaunie du lieu dit Le Champ-des-Perrières, les
débats à l’ombre des dix chapiteaux ont été aussi suivis que
les discussions sous les auvents des buvettes, accoudé aux bottes de
paille formant comptoir.
Les six points qui dessinent l’avenir de la Zad
Rappelant
qu’il a été « longuement
débattu à plusieurs reprises, dans de multiples composantes et
espaces d’organisation du mouvement »,
le texte Les
6 points pour l’avenir de la Zad
se trouve sur les tables de bien des stands. Un manifeste publié fin
2015, après un an et demi de gestation, dont les engagements se
voient ravivés avec l’éventualité, jamais aussi plausible, d’un
possible abandon du projet. Il s’agit d’assurer le maintien des
occupants, zadistes et agriculteurs historiques, sans expropriation
ni expulsion.
S’y
ajoutent la continuation des expérimentation agricoles et
d’auto-construction et la capacité à régler les conflits d’usage
au sein d’une instance collective issue de la lutte. L’accueil de
nouveaux projets doit aussi être arbitré par une entité dans le
droit fil des équilibres entre composantes de la lutte. Enfin ce
manifeste affirme, à contre-courant de la logique agricole
dominante, le refus de la dispersion des terres aux fins
d’agrandissement d’exploitations limitrophes déjà existantes.
Et donc au détriment de nouvelles installations. « En cas
d’abandon du projet, il y a un gros risque que les terres aillent
’à l’agrandissement’. Aujourd’hui la tendance en
agriculture, ce sont de grosses sociétés capitalistes
internationales qui investissent. Mais ici, on continuera à se
bagarrer pour que la Zad soit une terre partagée, de projets paysans
mais pas que », dit une zadiste.
Une tradition de luttes paysannes
Pour
envisager les perspectives, les militants anti aéroport se sont
souvent appuyés sur l’histoire récente. Sous le chapiteau de
l’actuel collectif paysan Copain, avant que se réchauffe un bœuf
bourguignon patates, à un jet de motte de terre des cantines
véganes, majoritaires ici, un débat explique les conditions de la
naissance de ce syndicalisme paysan combattif. Dans les années
soixante-dix, contre des paysans « accapareurs »,
les paysans-travailleurs ont multiplié en Loire-Atlantique les
occupations de ferme. Quarante ans plus tard, certains de ces paysans
sont là, assis sur les bottes de pailles en cercle, passionnés par
les enjeux politiques et agricoles de Notre Dame des Landes. En ce
département où le syndicalisme paysan offensif et d’action
directe a modelé le paysage, le débat rappelle le rôle, l’apport,
la référence constante de Bernard Lambert. Paysan, député et
militant du PSU, Bernard Lambert a fondé le mouvement Paysans
travailleurs dont la Confédération paysanne est en quelque sorte la
continuation.
Lambert
a publié en 1970 un livre dont le titre donne le ton : Les
paysans dans la lutte de classes. L’historien René Bourrigaud
en donne le sens : « La création d’un syndicat de
classe était une révolution historique dans l’affrontement
d’alors, entre le bloc rural, monarchiste et catholique, attaché à
la propriété foncière, et un bloc national et républicain appuyé
sur le mouvement ouvrier. Mais quand Bernard Lambert écrit son
livre, la paysannerie est en train de passer sous la domination du
capital agroalimentaire et s’il ne sont peut-être pas exactement
des prolétaires, ils sont les alliés objectifs des ouvriers »
Réseau de ravitaillement
Sous
un autre chapiteau, des zadistes retracent par des lectures de textes
et de témoignages l’alliance paysans ouvriers en Mai-68 à Nantes,
le ravitaillement des usines en grève et des quartiers populaires.
Un projet récent s’en inspire. Le réseau
Cagettes des terres est une résurgence adaptée à nos temps,
équivalent alimentaire du principe de la caisse de grève, apportant
légumes frais, repas préparés par une cantine volante ou produits
transformés aux piquets de grève, pour les mouvements sociaux qui
pourraient se former à l’automne prochain.
Ce
réseau de soutien alimentaire aux piquets de grève, regroupe des
zadistes et des paysans qui font déjà de manière disparate cet
apport aux luttes, aux squats de migrants, avec l’aide de
propriétaires de véhicules pour collecter les apports et les
acheminer aux grévistes, ainsi que de financeurs particuliers pour
couvrir les frais de ce système de solidarité.
Pendant
la loi travail, des contacts ont été pris entre des zadistes et la
CGT des salariés de l’actuel aéroport, géré par Vinci. D’un
côté, un collectif syndical contre l’aéroport s’est constitué,
formé de militantes et militants de quelques sections CGT de
Solidaires et de la CNT locale, alliés au collectif paysan Copain.
Le mot d’ordre de ce regroupement c’est : « Ni
travaux ni expulsion », en défendant le développement de
l’actuel aéroport et des conditions de travail décentes pour les
salariés directs et les sous-traitants.
L’organisation
d’un cortège au 1er Mai, un millier de personnes, des
tracteurs et des drapeaux spécifiques, dans un cortège de 6.000
manifestants, a donné confiance et appris à s’organiser. La CGT
Vinci au plan national et la CGT du bâtiment ont rejoint ce
collectif qui a déjà édité des tracts en six langues à
destinations d’éventuels travailleurs détachés. Ce collectif
syndical participe à la construction de ce réseau de ravitaillement
des luttes.
Quels
que soient les échéances et les volontés du gouvernement, la Zad
bouillonne d’énergies et de projets qu’elle mène pour
construire, toujours construire. Construire des projets, des réseaux,
des relations humaines et politiques et des stratégies communes.
►La
semaine "intercomités"
initialement prévue du 7 au 13 août est annulée, on réfléchit à
la reporter en début d’automne pour peut-être l’intégrer à un
moment plus large autour de l’avenir de la zad. On vous tient au
courant !
►La
CGT Air France soutient la lutte contre l’aéroport à NDDL !
►Au
gré des chemins de la zad : une nouvelle brochure pour
parler des sentiers sur la zad. La question a fait, fait toujours
polémique sur la zone occupée. Ce texte présente 3 parcours de
randonnée possible à l’aide de cartes, ainsi que quelques pistes
pour le faire de manière intelligente en prenant en compte que
l’espace est occupé/habité, par ex :
* respecter
l’intimité des habitants en portant attention aux recommandations
affichées sur les lieux de vie et en ne prenant pas d’images sans
le consentement des personnes.
* ne
pas perturber les troupeaux de bovins, préserver les cultures ou
prairies, en longeant les haies et en refermant les clôtures quand
nous traversons les parcelles et en tenant les chiens en laisse.
* ne
pas piétiner la flore et déranger la faune à la lisière des
sentiers.
►Nantes
La
letttre à Lulu, c’est un chouette petit canard nantais,
indépendant et, entre autres choses, résolument contre le projet
d’aéroport. Alors on a le plaisir de vous annoncer la sortie du
numéro n°97.
Disponible
en kiosque en vrai papier, avec de vrai fifrelin.
Lettre aux comités
Lettre
aux comités ZAD – NDDL / 2016-2017 Quelques récits et infos du
terrain.
En
vue de tournées sur la zad dans d’autres pays, puis de donner des
nouvelles aux comités de soutien plus proches, nous avons compilé
quelques éléments d’histoires et d’infos sur les 18 derniers
mois. Nous voulons contribuer, par ces mots , à faire vivre la
mémoire de cette séquence fiévreuse et à envisager ensemble la
suite du mouvement. Cet assemblage a été fait par quelques
habitant.e.s de la zad. C’est un point de vue singulier sur cette
période, qui ne se prétend ni exhaustif ni être la voix collective
des occupant.e.s.
Quelques
habitant.e.s de la zad
Un
pdf est disponible ici si vous souhaitez une version pdf mise en
page.
2016 - Sans répit, conjurer la menace
Le
30 décembre 2015, un mois après la fin de la COP 21, les
paysan.ne.s et habitant.e.s « historiques » de la zad de
Notre-Dame-des-Landes reçoivent une convocation au tribunal.
AGO-Vinci demande une expulsion immédiate, des amendes quotidiennes
drastiques en cas de refus, ainsi qu’une possibilité de saisie des
biens et du cheptel. Puisque le gouvernement n’ose revenir en
l’état sur le terrain, il tente ainsi d’isoler quelques
personnes clés qu’il espère pousser au renoncement en les
asphyxiant financièrement. Le président avait pourtant promis
d’attendre l’épuisement des recours d’aéroport contre le
projet d’aéroport pour expulser les habitants historiques de la
zad.
Face
à cette menace nouvelle, une manifestation s’organise en dix
jours. Le 9 janvier 2016, 20 000 personnes, des centaines de
cyclistes et 400 tracteurs convergent sur le périphérique de Nantes
et occupent le pont de Cheviré. À l’initiative de COPAIN, 60
tracteurs restent entremêlés au pied du pont à l’issue de la
manifestation afin d’obtenir l’abandon des procédures
d’expulsion. Un camp s’établit immédiatement au milieu de la
quatre-voies avec des barnums, de la paille pour dormir, un four à
pizzas, de la soupe à l’oignon et une radio mobile. Il est
encerclé, puis attaqué pendant la nuit par la police. Sous les tirs
de lacrymos, les manifestant.e.s entassées dans des remorques
agricoles sont alors contraintes de repartir en exode sur la
quatre-voies. Après une assemblée surchauffée le lendemain à la
Vache-rit, s’ensuivent plusieurs jours de blocages en tracteurs et
d’opérations escargot sur les routes de la région afin de
maintenir la pression. Des dizaines de manifestations, actions et
sabotages ont de nouveau lieu partout en France. Cela n’empêche
pas le procès de se tenir le 13 janvier et d’amener 3000
manifestant.e.s sur le parvis du tribunal. Le 25 janvier, le juge
rend expulsables les habitant.e.s et paysan.ne.s de la zad, mais sans
astreintes financières. Quelques jours plus tard, un millier
d’ « ouvrier.e.s des communs » répondent à
l’« appel d’offres » lancé par le « Comité de
pilotage pour un avenir sans aéroport ». Il s’agit d’une
réponse aux appels d’offres officiels que la préfecture a
récemment rendu publics. Celle-ci, après diverses campagnes de
pression et une série de sabotages, a de son côté de plus en plus
de mal à trouver des entreprises volontaires pour les travaux
préliminaires. Mais sur la zad, sous une pluie battante, de nombreux
chantiers ont lieu simultanément pour renforcer les structures
collectives : aménager une auberge, une salle de réunion, une
bergerie ou ouvrir de nouveaux chemins…
Alors
que le gouvernement, sous pression, annonce par la voix du Premier
ministre que le démarrage du chantier de l’aéroport sera repoussé
une nouvelle fois à l’automne, la ministre de l’Environnement
déclare qu’il ne peut y avoir d’expulsion par la force de la zad
sans risquer « une guerre civile ». Le nouveau président
de Région se déchaîne quant à lui quasi quotidiennement contre
les « ultra-violents » de la zad, « zone de
non-droit » qu’il compare à « Mossoul » ou
« Damas ». Il fait acheter au Conseil régional des
encarts publicitaires dans les journaux pour lancer une pétition
demandant l’évacuation de la zone. Le site du Conseil régional
est alors victime d’un piratage révélant que la pétition est
pleine de fausses signatures et de doublons.
Le
11 février, à l’occasion d’un remaniement ministériel, le
président Hollande négocie l’entrée au gouvernement de quelques
élus écologistes aux dents longues et tente de se sortir du
bourbier en annonçant un référendum sur le projet d’aéroport.
Pas dupes de cette entourloupe, plus de 60 000 opposants occupent
deux semaines plus tard les quatre-voies proches de la zad, s’offrent
un concert sur le bitume et soutiennent la construction d’une tour
de guet en acier de dix mètres de haut. Celle-ci s’ancre à
l’endroit même où sont censés commencer les premiers travaux du
« barreau routier », supposé relier les routes
existantes à l’aéroport en projet. A proximité de la
quatre-voies, la maison de La Pointe,expulsée en 2012, est réoccupée
pour une grande fête. Le 27 février devient la plus grosse
mobilisation du mouvement anti-aéroport. Le 25 mars, une quarantaine
d’action ont lieu simultanément aux quatre coins du pays, visant
principalement les locaux du Parti Socialiste en tant que parti au
gouvernement et promoteur du projet d’aéroport : occupation
de la mairie à Brest, avis d’expulsion et fermeture du local du PS
à Loches ou à Bayonne, locaux du PS redécorés, repeints ou murés
à Douarnenez, Villeurbanne, Saint-Denis, Niort ou Rouen, déversement
de sacs de terre dans celui de Valence, construction d’un mur
devant la sous-préfecture à Issoire, déambulation au son d’une
cornemuse à Blois et référendum de rue à Bressuire, procès du
gouvernement à Pontivy et manifestation devant la sous-préfecture à
Chalon-sur-Saône, pique-nique devant la mairie à Lorient ou
distribution de frites à Foix, déambulation et connexion avec la
lutte contre la ferme-usine des 1400 veaux à Guéret, lecture
publique d’histoires de la ZAD à Nantes, rassemblement devant le
siège du PS à Paris, déambulation à Saint-Herblain ou Redon,
carnaval à Toulouse et rassemblement dans le Cher, beach-art à
Saint-Malo, jeu de l’oie à Saint-Nazaire…
Pendant
tout l’hiver, des équipes d’habitant.e.s de la zad sollicitées
par les comités partent en tournée d’information à des centaines
de kilomètres à la ronde. Ils animent des discussions dans des
salles des fêtes, des cinémas, des MJC ou même dehors quand des
mairies interdisent l’accès à leurs locaux.
Solidarités
nouvelles et consultation biaisée :Pendant les quatre mois que durent le mouvement Loi Travaille !, les rues de Nantes et Rennes sont particulièrement agitées. Des bâtiments et places publiques sont occupés et des dizaines d’établissements bancaires fermés durablement après des attaques successives. Les blocages économiques et les affrontements avec la police se multiplient comme des signes de colère et d’espoirs qui dépassent de loin la question d’une nouvelle réforme précarisant un peu plus le monde du travail. La zad est présente sous diverses formes dans ce grand chambardement et participe aux manifestations et à divers blocages comme celui de la raffinerie de Donges. Des liens plus denses se tissent avec le monde syndical. Tandis qu’au niveau national les travailleurs syndiqués CGT du groupe Vinci refusent de participer aux éventuels travaux de l’aéroport en affirmant dans un communiqué « Nous ne sommes pas des mercenaires ». Une tentative de blocage de l’aéroport existant à Nantes est organisée conjointement par des travailleurs du site et le mouvement anti-aéroport. Cette action porte sur des revendications liées aux conditions de travail mais affirme aussi une opposition à la construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Le
dimanche 26 juin, les électeurs de Loire-Atlantique sont appelés à
voter pour ou contre le transfert de l’aéroport de
Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. L’ensemble des
composantes du mouvement – syndicats, associations, paysans,
naturalistes, élus, occupants – avait affirmé clairement qu’elles
considéraient « le cadre, le processus et le contenu de cette
consultation » comme « fondamentalement biaisés ».
Ils avaient décortiqué pourquoi la consultation était « basée
sur une série de mensonges d’État et radicalement inéquitable. »
Pendant le week-end électoral, rebaptisé « refaire un dôme »,
de nombreux soutiens viennent de nouveau participer à des chantiers
et notamment à la construction d’un dôme en terre paille qui
puisse servir de nouvel espace d’assemblée. À la fin du week-end,
le oui l’emporte à 55 %. Dans le hangar de la Vache-rit bondé
et tandis que des centaines de personnes scandent « résistance ! »,
une déclaration commune est faite : « Nous savons que les
attaques du gouvernement et des pro-aéroport vont se renforcer. De
notre côté, nous n’allons pas cesser pour autant d’habiter,
cultiver et protéger ce bocage. Il continuera à être défendu avec
la plus grande énergie parce qu’il est porteur d’espoirs
aujourd’hui indéracinables face à la destruction du vivant et à
la marchandisation du monde. Nous appelons tous les soutiens et
comités partout en France et au-delà à se mobiliser et à
redoubler de vigilance dans les semaines et mois à venir. ».
S’ensuit une grand nuit de fête.
Le
lendemain de la consultation, le gouvernement affirme de nouveau
qu’il viendra expulser la zad et démarrer les travaux en octobre.
Mais il est de plus en plus visible que son opération d’enfumage
démocratique n’a réussi ni à affaiblir le mouvement ni à le
diviser. 10 jours plus tard, 25 000 personnes convergent pour le
traditionnel rassemblement d’été et se donnent rendez-vous pour
une nouvelle manifestation massive sur la zad en octobre.
A
l’orée de l’automne 2016, la zad n’est pas tétanisée par la
perspective d’un nouveau débarquement armé. Les cultures et
constructions foisonnent, une bibliothèque et un point d’accueil
sont inaugurés. Soixante charpentier.e.s sont venus travailler
ensemble sur place fin août pour réaliser avec des outils manuels
et des techniques traditionnelles le “hangar de l’avenir”,
destiné à être levé lors de la mobilisation du 8 octobre et à
servir d’atelier de construction bois. La préparation aux
expulsions et la possibilité d’une destruction de la zad prennent
une place croissante dans le quotidien et les assemblées. Tous les
week-ends, des formations « prêt.e.s à défendre la zad ? »
rassemblent des dizaines de personnes de tout âge, malgré les
appels du Président de région pour faire interdire ces « camps
d’entraînement à la guérilla ». Le 8 octobre, au moment où
le Premier ministre entendait démarrer les expulsions, 40 000
manifestants convergent de nouveau par divers chemins sur la zad, en
martelant le sol aux cris de « Nous sommes là, nous serons
là ! ». Chaque manifestant.e était invité.e à venir ce
jour là armé.e d’un bâton et à le planter sur un talus à côté
de la ferme de Bellevue. Le serment y est fait de venir reprendre les
bâtons pour défendre la zad en cas d’attaque. Au lendemain de la
manifestation, Manuel Valls, Premier ministre, déclare fermement :
« L’évacuation c’est pour cet automne. Ça se fera. Il ne
peut pas y avoir d’autre voie. » Il le répétera semaine
après semaine à l’Assemblée nationale. Cette fois, et
contrairement à 2012, c’est la quasi totalité des lieux de la
zone qui est menacée d’expulsion par la force. C’est-à-dire non
seulement les personnes qui s’y sont installées pour y vivre et la
défendre ces dernières années, mais aussi les "historiques".
Le ministère de l’Intérieur prévoit la mobilisation de 5000
policiers et donc de la totalité des troupes qui ne sont pas déjà
en poste dans le cadre de l’état d’urgence.
Nous
entrons alors dans une période d’attente agitée où les signes de
solidarité se multiplient depuis des strates multiples de la
population. Il s’agit pour le mouvement de dresser les remparts
nécessaires, matériels et symboliques, pour ne jamais leur laisser
de brèches qui leur permettent de lancer une attaque. Les différents
groupes de la zone – presse, communication interne et externe,
radio, équipe médicale, légale, zad news – se coordonnent et se
préparent. Des tracteurs font des allers et retours pour répartir
des amoncellements de pneus, poteaux et balles de foin aux seize
points d’entrées de la zad. Des guets sont établis
quotidiennement, des alentours directs jusqu’à Rennes, afin de
pouvoir, à point nommé, déclencher avec les comités locaux le
plan de blocage de la région. Des lycéen.ne.s et étudiant.e.s
s’assemblent pour être à même de manifester et bloquer leurs
établissements le jour J. Des habitant.e.s proches se préparent à
ouvrir leurs maisons et leurs granges, des soignant.e.s,
professionnel.le.s ou non, s’apprêtent à s’occuper des éventuels
blessé.e.s sur le terrain le moment venu, et des juristes à réagir
aux mesures répressives que le gouvernement mettra en place. Des
élagueuses et grimpeurs s’entraînent à monter à la cime des
arbres menacés d’être abattus. Des journalistes indépendant.e.s
et activistes des réseaux sociaux discutent de comment relayer au
mieux les infos des opposant.e.s et contrer la propagande du
gouvernement. Des romancier.e.s et philosophes construisent un
abécédaire et débarquent en bus sur la zad avec des boucliers de
livres. Des soutiens s’organisent à des centaines de kilomètres
et aux quatre coins de l’Europe pour être parés à nous rejoindre
au plus vite. De nouvelles personnes viennent sur la zad pour être
sur place en cas d’attaque et finissent par s’y installer.
Le
7 novembre, à la surprise générale, Mme le « rapporteur
public » émet un rapport défavorable pour le procès en appel
sur les mesures environnementales liées au projet d’aéroport.
Elle explique : « On peut bien se passer d’un nouvel
aéroport. On ne peut pas se passer d’eau ». L’avis du
rapporteur est d’ordinaire suivi par les juges, qui doivent dans la
foulée statuer de nouveau sur le dossier. Pendant une semaine, tout
le monde part donc du principe que le projet devrait logiquement être
stoppé, avec une porte de sortie judiciaire. Mais le 14, les juges
de la cour d’appel du Tribunal Administratif décident, envers et
contre tout, de rester dans la droite ligne des élites locales et de
confirmer la « conformité » de l’aéroport. Le 22
novembre, des pirates informatiques facétieux font subir une chute
vertigineuse au cours des actions Vinci grâce à un faux communiqué
du groupe annonçant des malversations. Au cours du mois de décembre,
les annonces martiales du gouvernement s’affaissent et l’on ne
prévoit plus qu’un « démarrage de travaux » aux
abords de la zone. Des balades du dimanche y sont organisées avec
les comités pour repérer les lieux.
Le
21 décembre, la date limite annoncée pour les expulsions est
passée ! On célèbre la fin de l’automne, la démission du
Premier ministre quelques jours plus tôt et la conjuration de la
menace… pour un temps au moins.
2017 – Mettre les deux pieds dans l’avenir
Tout
au long de l’hiver se déploie “abracadabois”, un processus
d’étude, de rencontres et de chantiers sur la forêt. Après la
prise en charge autonome d’une partie des champs et prairies, il
s’agit d’aboutir à celle des haies et forêts de la zad, autant
pour répondre aux besoins en bois d’œuvre et de chauffage que
pour les rendre plus riches et belles pour les siècles à venir. Des
rencontres sont organisées avec des travailleurs du bois et des
acteurs du réseau des alternatives forestières. Des coupes sont
effectuées au cours de l’hiver pour diverses constructions sur la
zad.
Les
mois de janvier et février sont aussi marqués par des assemblées
du mouvement qui ne baissent pas la garde et pendant lesquelles un
calendrier d’action est posé jusqu’à l’automne pour maintenir
le front et se préparer à l’hypothèse alors la plus probable :
l’arrivée au pouvoir de Fillon, de son vizir Retailleau et une
attaque frontale et décomplexée sur la zad dès l’automne.
Attaque qu’il paraissait alors difficile de repousser de nouveau à
priori. Mais la suite indécente de scandales qui frappera le clan
Fillon dans les mois qui suivront finira par l’enterrer, et par
nous forcer à envisager de nouveaux scénarios un peu moins abrupts.
Depuis
Nantes, une nouvelle composante de la lutte se structure, « le
collectif syndical contre l’aéroport » avec entre autre
des travailleurs.euses de l’aéroport existant. Avec l’appel
« Reprendre sa vie en main : une idée qui nous parle »,
ils mettent en avant comment défendre la zad va pour eux au-delà du
refus du projet d’aéroport : « c’est aussi soutenir
une expérience d’émancipation du capitalisme et des rapports
marchands. ». Ils disent espérer voir cette idée se diffuser
aussi à l’intérieur des entreprises et du monde salarié.
Le
25 février 2017, la zad appelle à rejoindre la manifestation
organisée contre la venue de Marine Le Pen pour son premier grand
meeting électoral à Nantes. Alors que les réactions au viol du
jeune Theo par un policier à Aulnay-sous-Bois secouent le pays, une
partie importante du cortège s’affronte ce jour là avec les
forces de l’ordre. Le lendemain deux bus de supporters du front
national se rendant au meeting sont immobilisés sur la quatre-voies
Rennes-Nantes, au moyen de feux, et entourés par quelques dizaines
de personnes masquées qui les arrosent de peinture. Pendant la même
période, des rencontres autour des persécutions policières sont
organisées sur la zad et des liens tissés avec des familles de
victime ou encore avec l’assemblée des blessés. Le 19 mars, deux
bus partent de la zad et Nantes pour participer à la marche de la
justice et la dignité à Paris. Des échanges se poursuivent tout au
long du printemps avec des groupes qui se battent en banlieue ou
ailleurs sur les questions de racisme et de répression.
Dans
la série initiatives de l’ennemi et embrouilles judiciaires,
l’Etat avait décidé en février de s’attaquer à nos outils de
solidarité, en convoquant des personnes qui sont titulaires d’un
compte bancaire lié au comité de soutien aux inculpé-e-s à
Nantes. La gendarmerie les avaient interrogé dans le cadre d’une
instruction par rapport à un vieux délit de presse, qui interdit de
faire des appels à dons en vue de payer des amendes et des frais de
justice (une loi de 1881). C’est la première fois que de telles
poursuites se mettent en place à l’encontre d’une des diverses
caisses de solidarité qui existent en France. Depuis, la gendarmerie
a aussi tenté d’interroger sept personnes qui ont reçu de l’aide
du comité. L’attention reste de mise sur les suites de cette
affaire et les mobilisations nécessaires.
Le
1er avril, une fête « Notre-Flamme-Des-Landes » se tient
pour l’inauguration du phare construit à la Rolandière et pour la
migration de la bibliothèque du Taslu à ses côtés. Une chaîne
humaine déménage les livres de la main à la main depuis l’ancien
Taslu. Pendant ce temps, un groupe parti en courrant depuis Nantes
avec des torches se voit accueilli et renforcé au passage par les
comités de la Chapelle-sur-Erdre, Treillères et la Paquelais,
jusqu’à son arrivée sur la zad et à l’embrasement du phare.
Au
cours du printemps, des tensions émergent au sein du mouvement, sur
la place laissée aux différentes formes de présence, d’action,
sur les formes d’organisation et leur réappropriation ou sur
l’ouverture de la zad, entre autre... Il y a aussi de nouveaux
différends sur la route d281, dite « route des chicanes »,
et ses divers usages : personnes habitants le long de la route,
passages de véhicules agricoles, passages d’autres véhicules et
voisin.e.s. Tout cela est ponctué d’un paquet de débats entre
occupant.e.s ou avec les autres composantes sur ce qui fait
désaccord, mais aussi sur ce qui pourra permettre de continuer
ensemble en reclarifiant les bases communes.
D’autres
projets ont vu le jour ces derniers mois : une cabane de soin et
de séchage de plantes médicinales sur le champ Rouge et
Noir. Celle-ci avait été préparée par un collectif rennais qui
est venu la monter sur place. Un garage autogéré ou un espace
poterie sont en voie d’être aménagés à la Grée. Un projet de
tannerie artisanale s’est mis en place au Hauts-Fay. Un certain
nombre d’habitats sont par ailleurs construits ou rénovés, une
nouvelle vague d’habitants étant arrivée sur la zad depuis
l’automne,
Les
semaines sur le terrain sont toujours rythmées, que ce soit par les
repas avec les paysans du vendredi midi, les ateliers rap du mardi,
les réunions du groupe de médiation « cycle des 12 » du
lundi, les chantiers au jardin Rouge et Noir le mercredi ou les
non-marchés du vendredi… entre autres rendez-vous des différentes
structures et cultures collectives, pour des groupes de parole ou des
groupes en concerts, des soirées jeux ou des matinées boxe, des
ramassages de patates ou des collectes d’idées, des rencontres sur
les pistes aborigènes ou la résistance anti-pipeline à Standing
Rock...
Par
ailleurs, deux premières « journées des 4 saisons » se
sont déroulées sur la zad. Ce sont des journées de chantiers
saisonniers sur les espaces communs de la zad, et de rencontres entre
les gens qui font vivre cette lutte et ce territoire. Il s’agit de
se consacrer à entretenir et construire ce qui est partagé le plus
collectivement. Lors des deux premières sessions, le 25 mars et le
19 juin, des nids de poules sont rebouchés sur la route des fosses
noires, une fontaine et un local poubelle sont construits, du bois
est transporté à Bellevue ou encore des fagots faits pour la
boulangerie...
Alors
que les sentiers historiques de la zad avaient disparu des cartes
distribuées dans les mairies, des boucles de randonnées ont été
balisées et détaillées dans un topo (disponible sur internet et à
la Rolandière). L’initiative a été proposée par les camarades
du comité de la Chapelle-sur-Erdre qui se sont battus depuis les
années 70 contre la privatisation des sentiers autours de chez eux
par les grands familles bourgeoises de la région.
Le
29 avril, à l’entre-deux tours des présidentielles, on fête par
un Fest-noz la fin du chantier de couverture en ardoise du hangar de
l’avenir. Une danse s’y élabore avec des bâtons en vue de la
manif du premier mai pendant laquelle se tient pour la première fois
un « cortège syndical contre l’aéroport » qui va
marquer les esprits par sa présence vibrante. Depuis, le hangar
continue à vivre avec la venue d’une scierie mobile du plateau de
Millevache et la fabrication de poutres et planches pendant le mois
de juin, puis un chantier-école de charpente pour lui offrir des
appentis en juillet.
A
l’issue des élections, certains des piliers historiques du projet
d’aéroport sont considérablement affaiblis : les éléphants
du PS sont en voie de disparition et le couple Retailleau/Fillon a
amené son parti à la perte. Hollande passe la patate chaude à
Macron et la zad se révèle d’emblée un des premiers dossiers
brûlants et clivants du nouveau gouvernement. Aussi puissant que se
sente le nouveau petit roi aux ardeurs versaillaises, il a pourtant
l’air de comprendre qu’il ne peut s’attaquer en même temps à
ceux qui se sont déjà trouvés dans la rue lors du printemps 2016
et à une commune libre qui mobilise autant de passions au-delà de
ses lisières... Il privilégie de hâter d’ici septembre la mise
en pièce de ce qui reste de protection dans le monde du travail et
décide de temporiser sur l’aéroport. Il annonce à la mi-mai la
mise en place d’une médiation de six mois pour « réétudier »
le projet. Quelques jours après, des centaines de personnes des
alentours viennent se balader sur la zad et découvrir les lieux lors
d’une journée portes ouvertes ensoleillée.
Courant
juin, certaines composantes du mouvement font le choix d’aller
porter leur point de vue aux rendez-vous proposés par la médiation.
D’autres, comme les occupant.e.s et COPAIN, décident de rester en
dehors. La médiation représente en tout cas bel et bien un nouveau
recul dans lequel l’État en est réduit à s’asseoir visiblement
sur ses propres alibis démocratiques et sur la farce de la
consultation de l’année passée. Contrairement à la « commission
du dialogue » mise en place après l’échec de l’opération
César, ce processus a pour nouveauté d’intégrer l’hypothèse
que l’aéroport ne se fasse pas et ainsi que la possibilité d’une
simple « optimisation » de celui qui existe déjà à
Nantes. C’est la conséquence de l’échec de tous les autres
stratagèmes essayés jusqu’ici par le gouvernement : les
pressions judiciaires et financières, les dispositifs
d’acceptabilité, les stigmatisations incessantes de la zad, la
force policière brute et les tractopelles. Avec la médiation, le
gouvernement cherche à faire croire à un processus neutre et
objectif au sein duquel les débats pourraient être tranchés par
des experts de manière quasi-scientifique. C’est surtout une
manière pour lui de tenter de neutraliser le conflit et de garder la
face. Mais quelle que soit la conclusion donnée par le pouvoir à
cette séquence, elle ne résultera pas de critères techniques mais
bel et bien d’une décision politique, déterminée par des
rapports de force.
Il
est possible que Macron s’obstine au final à mener à bien la
construction de l’aéroport et à retenter la grande expulsion
d’ici quelques mois. On peut parier que le mouvement restera alors
aussi combatif qu’il l’a été jusqu’alors avec un tas de
nouveaux complices. Il peut tout aussi bien décider de se
débarrasser d’une partie du fardeau et enterrer le projet, pour
mieux essayer ensuite de ramener de force la zad dans le giron de la
République. Le 4 juillet, la préfète de Loire-Atlantique a répété,
qu’aéroport ou pas, les expulsions auraient bien lieu. Au-delà de
la victoire historique que représenterait l’abandon de l’aéroport,
celui-ci annoncerait l’ouverture immédiate d’une nouvelle phase
de la lutte.
En
ce sens, les opposants locaux – paysans, habitant.e.s, occupante.s,
comités – continuent à élaborer ensemble, pas à pas, les bases
d’un avenir commun au-delà de l’aéroport et d’une zone qui ne
rentre pas dans le rang. L’objectif est que les formes de vies,
d’agriculture et de luttes qui se sont construites sur ce bocage au
fil des années puissent s’y maintenir et se poursuivre. Ces bases
communes se sont élaborées après l’opération César et ont été
énoncées en 2015 dans le texte dit des 6 points : « Parce
qu’il n’y aura pas d’aéroport » (voir à la fin). Ces
bases se traduisent, entre autre, par une volonté que le territoire
soit pris en charge par une entité issue de la lutte. Cela implique
un refus de toute expulsion des habitants actuels de la zad, ainsi
qu’un gel de la redistribution institutionnelle de l’ensemble des
terres concernées par l’aéroport, afin de laisser au mouvement le
temps de décider de leur usage.
Des
initiatives l’affirmeront en pratique au cours des prochains mois
avec des installations partiellement légales de paysans compagnons
de la lutte ou de projets sans aucun statuts officiels, agricoles ou
non. Des assemblées et réflexions reprennent, à la fois pour
renforcer l’usage actuel du territoire, les communs, et pour
nourrir les hypothèses sur les moyens d’arriver à la traduction
concrète des aspirations du mouvement en cas d’abandon du projet.
En
attendant, des habitant.e.s de la zad et des paysan.ne.s de COPAIN se
préparent à être aux côtés de celles et ceux qui résisteront
dans les rues à l’automne. Des rencontres récentes ont eu lieu
avec des représentants du Front Social, coordination née autour de
Paris après le mouvement loi travail. Des convergences se sont
trouvées, dans cette dynamiquen à Nantes comme ailleurs, en vue de
ne pas laisser passer les ordonnances de Macron sur la réforme du
travail ou sa volonté d’ancrer dans des lois permanentes l’État
d’urgence. Des structures de piquets volants et des réseaux de
ravitaillement paysans des grèves et blocages à venir s’élaborent
dans le bocage.
ps :
Un hameau de la zad est toujours à l’affiche au cinéma – avec
le film « les pieds sur terre » sur le Liminbout. Il est
encore possible pour les comités de faire passer le film jusqu’en
novembre dans leur cinéma local et d’inviter des personnes du
mouvement à des interventions après les diffusions. D’autres
peuvent se rendre disponibles pour venir animer des soirées sur la
suite de la lutte et l’avenir de la zad. Pour faire des
propositions en ce sens : zadinfotour@riseup.net
ps2 :
Un an après les syndicats CGT de VINCI, c’est maintenant la
Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et
de l’Ameublement CGT tout entière qui se prononce pour l’abandon
du projet d’aéroport et contre l’expulsion des habitants de la
zad. Lors de son congrès du 22 juin, plusieurs délégués ont
exprimé leur souhait « de travailler sur des projets
socialement utiles et nécessaires (comme des logements sociaux ou
des hôpitaux), plutôt que sur des projets aussi dispendieux que
contestables (comme le Grand Paris ou la Nouvelle Route du Littoral,
à La Réunion). »
Un
contact pour des retours et échanges sur cette lettre :
exclaimthezad@riseup.net
Prise de position de l’assemblée des occupant-e-s à propos de la médiation
À
toutes celles et ceux qui luttent encore et toujours contre
l’aéroport et son monde, Face à notre détermination commune, le
gouvernement peine à ne pas perdre la face. Il tente de faire croire
à une médiation qui n’est que poudre aux yeux, destinée à nous
endormir, alors que l’enjeu n’est certainement pas là.
Le
débat politique n’a pas lieu, escamoté par une approche
« strictement technique ». Faut-il une profusion
d’expert-e-s en tout genre pour constater que le béton ne se mange
pas ?
La
soi-disant « neutralité » des médiateurs-rices cache
mal le désir étatique de neutraliser la zone. Ne nous méprenons
pas, c’est grâce à la résistance sous toutes ses formes que
l’aéroport ne s’est pas fait et ne se fera pas.
Dans
un tel contexte, il nous est important de redire notre profond
souhait de continuer à œuvrer avec nos camarades des autres
composantes de la lutte, tout en renforçant nos liens avec d’autres
luttes, et ce, quel que soit le résultat de la médiation.
Car
en cas d’abandon du projet d’aéroport, s’ouvrira une nouvelle
lutte qui aura besoin d’autant de détermination, pour que tout ce
qui a été fait jusqu’ici s’enracine et se dissémine.
Ici
comme ailleurs, soyons autonomes et solidaires.
Résistance !
Des
occupant-e-s et habitant-e-s de la ZAD
Infos du 17 au 23 juillet
►« On
s’est dit : “il y a des champs de libre, allez hop on
bétonne tout ça” » a dit le ministre de l’écologie dans
une interview au sujet de l’aéroport. On attend de voir si son
gouvernement en tirera vraiment les conséquences… l’interview
complète :
Quid
de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?
Tout
le monde connaît mon opinion là-dessus, je n’ai jamais été
convaincu par l’utilité du projet. Maintenant, le dossier est dans
les mains des médiateurs, pour vérifier que tous les scénarios ont
été étudiés. La décision se fera de façon impartiale.
On
va y arriver un jour ?
C’est
devenu tellement passionnel… Très sincèrement, personne n’est
malhonnête dans ce dossier mais tout le monde n’a pas la même
grille de lecture. Je ne suis pas en conflit avec M. Retailleau,
je respecte son point de vue, je le comprends mais ne le partage pas.
Je veux que le dialogue et la raison l’emportent, sans violence
verbale et encore moins physique. Il y a des besoins avérés pour
absorber le trafic mais on a été au plus facile, tout n’a pas été
étudié. C’est l’héritage d’une décision prise il y a 30
ans. On s’est dit : « il y a des champs de libre, allez
hop on bétonne tout ça ». Ce sont des logiques
dépassées.
(Interview
par Ouest
France)
►AntiRep
Et hop, les mesures de l’état d’urgence passent tranquilou dans le droit commun, à la faveur d’ une énième loi "antiterroriste" validée par le sénat, et qui passera à l’assemblée nationale en octobre." Le gouvernement souhaitant une adoption rapide, il a demandé la procédure accélérée ".
En marche accélérée pour le "despotisme doux" ? Gare à la riposte délicieuse...
►AntiRep
Adama Traoré a été tué par des flics le jour de ses 24 ans il y a un an. Depuis, la « justice » fait son job : elle couvre l’affaire, à coup d’approximations, voire de mensonges, de la part des pouvoirs publics »..Solidarité avec la famille, les proches, et tout-es celleux qui luttent contre la criminalité et l’impunité policière. "Ce qui se passe dans les quartiers s’inscrit dans le prolongement de l’histoire de l’esclavage, puis de la colonisation. Le présent est une suite logique de la construction de cet État colonial. », rappelle Assa Traoré dans un entretien.
Ni
oubli ni pardon.
►Luttes sociales :
Quant à la France, aujourd’hui Macron saupoudre une jolie poussière environnementale-durable-bobo-bio d’un côté (ici et là ), tout en réduisant les aides sociales au logement de 5€ pour tout le monde et en inscrivant l’état d’urgence dans le droit commun de l’autre…
►Et
pendant ce temps-là, on
ne demande toujours rien à l’aviation !
La
solidarité des militants de Plane Stupid (Angleterre)
avec les
opposants à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Infos du 24 au 31 juillet
Mercredi
26 juillet
►Radio Klaxon
Reprendre la parole, reprendre les ondes. Petit retour sur les radios de lutte, de Bure à Longo Mai, en passant évidemment par notre radio préférée, Radio Klaxon (que vous pouvez écouter en streaming là ou plus simplement sur la page d’accueil de ce même site !)« Zone à défendre » : le jeu collaboratif qui lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
Les
zadistes de Notre-Dame-des-Landes et des joueurs amis ont inventé un
jeu de plateau aussi coopératif que militant. Le temps d’une
partie, les joueurs usent de multiples moyens pour s’opposer à la
construction de l’aéroport controversé.
« Entre,
j’ai déjà sorti les pièces »,
lance Robin derrière le comptoir de son magasin Robin
des jeux, à Paris. Sur une petite table, un plateau découpé en
une multitude de zones, représentant chacune un pan de
Notre-Dame-des-Landes : « Ardillières »,
« Forêt de Rohanne », « Chêne des Perrières »…
Autant de cases qui dépeignent les lieux les plus connus des
habitués de la Zad. Les pions zadistes y côtoient des ronds bleus
où sont dessinées des matraques de CRS. Un immense poing vert
compte les points des joueurs sur un flanc du plateau. Encerclant la
partie supérieure de terrain, une série de cases va rythmer le
jeu : le « Tempo de Valls ».
« Clairement,
le jeu est politisé »,
plaisante Robin, qui a participé à son élaboration. Le projet aura
pris son temps : quatre années se sont écoulées depuis
l’éclosion de l’idée d’un jeu de plateau sur la Zad. La faute
à « une
équipe éditoriale
hardcore gamer qui
ne voulait pas sortir un jeu dont elle n’en serait pas pleinement
satisfaite »,
est-il expliqué sur
le blog de ses créateurs. Depuis le financement
Ulule, dont la collecte a encaissé 6.457 € sur les 5.000
espérés, le projet aura connu plusieurs maquettes. « La
première version était trop dans l’affrontement entre zadistes et
forces de l’ordre,
se rappelle Robin, le
jeu a évolué pour devenir plus coopératif. »
Et plus coloré : plateau et jeu de cartes ont reçu les soins
de deux dessinateurs, qui y ont apporté une touche humoristique pour
détendre l’ambiance d’affrontement.
La coopération est le maître-mot entre camarades de lutte
Même
la couleur des pions a été réfléchie, raconte Robin : « Nous
ne pouvions pas mettre de pions bleus à cause des forces de l’ordre,
mais chacun à une signification. Les rouges sont les communistes,
les noirs sont les black blocs, les verts… » Et les
jaunes ? « Les sociaux-traîtres ! » rit
le gérant, voyant que nous les avons choisis pour une partie
d’essai.
La
partie s’engage. À chaque tour, des bulldozers accompagnés par
les forces de l’ordre entrent par les coins du plateau pour
ratiboiser Notre-Dame-des-Landes. Seul ou en équipe, le joueur
affronte les éléments « du système », comme le
décrivent ses créateurs. La coopération est le maître-mot entre
camarades de lutte pour organiser une défense efficace, que ce soit
en cultivant des légumes pour nourrir les troupes ou en obtenant des
soutiens, matériels ou moraux. Au programme : « monter
une radio pirate », « construire une serre », « jet
de fumier » ou « câlins »… Les cartes
« compétences » proposent un éventail d’actions
pour lutter contre l’aéroport. De son côté, le « système »,
qui avance ses pions automatiquement, pratique une stratégie
d’étouffement : chaque affrontement contre les CRS accélère
le « Tempo de Valls » et augmente la présence des
forces de l’ordre au tour suivant.
Pour
remporter la partie, les zadistes en herbe ne doivent pas éliminer
les troupes adverses, mais accomplir un nombre suffisant de projets
collectifs. En revanche, si plus de neuf cases sont mises en
chantier, le bocage de Notre-Dame-des-Landes sera trop endommagé et
la partie, perdue. « L’équilibrage a été difficile,
nous ne sommes pas des professionnels, rappelle Robin. Nous
avions tendance à gagner constamment à force d’y jouer et d’en
connaître les rouages. »
Force
est d’avouer que, quand la rédaction de Reporterre a
ressorti le jeu pour une seconde partie, la tendance était plutôt à
perdre sous le poids des bulldozers avant d’arracher la victoire de
justesse.
Quant
aux recettes de la vente du jeu - il coûte 29 € -, elles
seront consacrées au soutien du mouvement de Notre-Dame-des-Landes
et à celui d’autres Zad. Mais, cerise sur la barricade, une
édition « Free
to Print »
en
licence libre du jeu est disponible pour les porte-monnaie les
plus légers.
Où trouver le jeu en boîte ?
.
A la ZAD de NDDL.
.
Auprès des comités
de soutien de NDDL.
.
A Paris, à La Petite Rockette, 125 rue de Chemin Vert, 75011, ou
chez Robin des Jeux, 37 Boulevard de Charonne, 75011.
.
Sur le net : chez Robin
des Jeux en ligne ou à La
Boutique militante de Contrevents.
AILLEURS
Et
ailleurs : A45
(42-69) -
LGV
Sud Bordeaux (33) – Bure
(55) – #
No
G20 à Hambourg
(Allemagne)
Infos du 1er au 9 juillet
Contre le projet autoroutier A 45, les naturalistes entrent en jeu
Prévu
entre Lyon et Saint-Étienne, le projet d’A 45 est porté par
Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne–Rhône-Alpes.
Un rassemblement d’opposition a lieu ce week-end du 1e juillet. Les
naturalistes ont inventorié de nombreuses espèces protégées.
Reportage photo.
- Sur le tracé prévu de l’A45, reportage
Filet
à papillons et jumelles en main, encyclopédie botanique dans le
sac, c’est une soixantaine de naturalistes de tous les âges et de
toutes spécialités confondues qui se sont mobilisés samedi 10 et
dimanche 11 juin pour inventorier la faune et la flore sur la
bande de terre menacée par le projet autoroutier de l’A45.
L’A45,
dont les premières études remontent à 1993, est supposée doubler
quelques kilomètres au nord l’autoroute A47 déjà existante entre
Lyon et Saint-Étienne. Celle-ci est jugée surchargée et
dangereuse. Laurent Wauquiez, le président de la région
Auvergne–Rhône-Alpes, a mis un grand coup d’accélérateur au
projet en faisant voter son financement. À plus d’un titre, 2017
devrait être une année clef pour l’avenir des terres situées sur
le tracé de l’autoroute.
 |
| Découverte d’une station de « Gratiola officinalis », une plante toxique protégée sur l’ensemble du territoire français. |
La
Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature), qui
organise tous les ans les « 24
h naturalistes »
dans le but de collecter des données d’un espace jugé sensible
ou à enjeu notable, a choisi cette année de s’intéresser à la
partie est de la future A45. Chaque année, 3.000 à 4.000 données
sur 400 à 500 espèces différentes sont recueillies, permettant de
dresser un état des lieux fiable du site observé. La quantité des
données collectées, la qualification poussée d’une partie des
bénévoles, ainsi que la connaissance cumulée du terrain pour les
membres de l’association, produit un résultat solide. Sur le
tracé prévu de l’A45, les naturalistes ont relevé une centaine
d’espèces protégées.
Effectuer des recours et ralentir la procédure
Au-delà
de l’intérêt scientifique lié à la connaissance des milieux
traversés par l’autoroute, le but est surtout stratégique.
D’autres collectifs de Naturalistes en lutte ont déjà démontré
leur efficacité dans l’élaboration d’une contre-expertise
valide devant les tribunaux, comme à Notre-Dame-des-Landes.
En
effet, chaque projet d’infrastructure doit être accompagné d’une
étude d’impact environnementale dans laquelle les espèces
protégées doivent figurer. Une autorisation de destruction de ces
espèces doit ensuite être délivrée par la préfecture. L’enjeu
est donc de débusquer un maximum d’espèces qui ne seront pas
mentionnées par le bureau d’études, dans le but d’effectuer des
recours et ralentir la procédure.
Les
données répertoriées sur le tracé de l’A45 seront regroupées
et décortiquées, puis une synthèse sera rendue publique lors du
grand weekend de mobilisation du 1er et 2 juillet, où une
marche contre l’A45 partira de Saint-Étienne en direction de Lyon.
L’AVENIR DE L’A45 ENTRE LES MAINS DU GOUVERNEMENT
La
balle est désormais dans le camp de l’exécutif. Mardi 27 juin,
le Conseil d’État a rendu un avis favorable au projet
d’autoroute A45. L’annonce a été faite par Gaël Perdriau,
le président de la métropole de Saint-Étienne et maire de la ville
du même nom, fervent soutien de la réalisation du nouvel axe
routier.
« Toutes
les étapes sont désormais franchies pour que la ministre des
Transports, Élisabeth Borne, chargée, au niveau gouvernemental, du
dossier A45,
(...) signe
le contrat avec le concessionnaire désigné pour la construction de
cette nouvelle autoroute »,
s’est-il réjoui dans un
communiqué. Il espère la mise en service du tronçon en 2022.
C’est
désormais au gouvernement de signer le décret validant le contrat
entre l’État et le groupe Vinci, qui exploitera la future
autoroute à péage. Le fera-t-il ? « On entre dans une
phase extrêmement politique du dossier », estime Maxime
Combes, l’un des porte-parole de la coordination des opposants au
projet.
Ces
derniers évaluent que « la
nouvelle autoroute ferait croître les kilomètres parcourus de 136 %
et la quantité de CO2
rejetée dans l’atmosphère de 85 % d’ici à 2035
(...). L’A45
n’est donc pas compatible avec un engagement sincère en matière
de lutte contre les dérèglements climatiques. »
Le collectif appelle le gouvernement à ne pas signer le décret.
« La
balle est dans le camp du Premier ministre, poursuit Maxime
Combes. Il se retrouve dans une situation étrange, où il a des
demandes d’élus de la République en marche contradictoires, car
ceux du côté de la Loire et de Saint-Étienne sont favorables,
alors que ceux dont les circonscriptions sont concernées par le
trajet sont plutôt opposés. Quant à Gérard Collomb [ministre
de l’Intérieur et ex-maire de Lyon], il n’a jamais appuyé ce
projet. »
De
son côté, Nicolas Hulot, ministre de tutelle d’Élisabeth Borne,
semble pour l’instant dans ses petits souliers. En marge d’un
déplacement à Lyon lundi 26 juin, il a déclaré qu’il
prendrait le temps de se faire sa propre « opinion
et de recevoir les acteurs »
concernés. « Il
y a des choix à faire dans les investissements. On ne va pas pouvoir
tout faire. Soit on considère que l’engagement climatique est un
petit engagement parmi d’autres, soit on considère effectivement
que c’est l’enjeu majeur du XXIe siècle et qu’il y a un
certain nombre de priorités qui vont s’inverser »,
a-t-il
ajouté.
Selon
le dossier de la déclaration d’utilité publique de 2008, les
48 km de l’A45 coûteraient 1,2 milliard d’euros. Ils
seront en partie financés par le concessionnaire Vinci, qui pourra
assurer l’exploitation et récolter les revenus du péage pendant
55 ans. Le reste doit être financé par des subventions
publiques pour près de 800 millions d’euros. La région
Auvergne–Rhône-Alpes, sous l’impulsion de son président LR
Laurent Wauquiez, a ainsi voté
une subvention de 132 millions d’euros en juillet dernier.
Le département de la Loire et la métropole de Saint-Étienne se
sont engagés pour des financements équivalents. L’État
assurera l’autre moitié des apports de fonds publics, soit
395 millions d’euros.
Outre
le délestage attendu de l’axe parallèle, l’A47, réputé
accidentogène, les défenseurs du projet espèrent que cela
permettra de rapprocher Saint-Étienne de Lyon et de revitaliser une
région qui subit encore les effets de la désindustrialisation.
Les
opposants pointent, eux, un financement sous-évalué, et évoquent
plutôt un chiffre de 1,5 milliard d’euros, en plus de
centaines de millions d’euros pour assurer les raccordements à
chaque extrémité. Ils s’inquiètent également de la destruction
de 500 hectares de terres agricoles et de la menace que le
projet ferait peser sur 375 fermes.
« L’A45
ne fera pas venir les investisseurs à Saint-Étienne, avertit
Maxime Combes. On a déjà un contre-exemple dans la région, avec
Valence, qui est très bien reliée par l’autoroute A6. Au
contraire, le risque est de devenir une ville dortoir. »
La
proposition est de plutôt valoriser l’agriculture de la région,
menacée par le projet. « Beaucoup de producteurs installés
sur le tracé du projet d’autoroute vendent en local. Il s’y
trouve notamment le tout premier magasin de producteurs de France,
Uniferme, fondé il y a 40 ans », raconte encore
Maxime Combes.
Une
vitalité que les opposants à l’A45 entendent bien montrer ce
weekend, lors de deux jours de fête qui, outre les concerts,
prévoient aussi une « tractorution » et un marché de
producteurs.
LGV à Bordeaux et à Rennes ?
Les écologistes bataillent contre le projet suivant, au sud de Bordeaux
La
SNCF et les métropoles de Rennes et Bordeaux fêtent ce weekend en
grande pompe la mise en service des deux nouvelles lignes à grande
vitesse au départ de Paris. Mais les opposants poursuivent la
mobilisation contre le prolongement de la ligne de Bordeaux vers le
sud. Ils viennent de remporter une victoire juridique, et font eux
aussi la fête ce samedi.
Rennes
à 1 h 25 de Paris contre 2 h 4 auparavant,
Bordeaux à 2 h 4 de la capitale contre 3 h 14
jusqu’ici. Ce samedi 1er juillet, le président de la
République sera le premier passager de la nouvelle ligne
Paris-Rennes, Bordeaux devant se contenter de la ministre des
Transports, Élisabeth Borne. Les premiers clients partiront, eux,
dimanche matin. Pour fêter cela, les deux métropoles ont vu les
choses en grand : Rennes habille le parlement de Bretagne aux
couleurs du train, Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine ont un
programme d’animation de deux jours. Jamais la SNCF n’avait
inauguré deux lignes à grande vitesse le même jour. Le moment est
quasi historique.
À
Bordeaux, l’enjeu est de taille, car outre l’objectif d’attirer
touristes et entrepreneurs, la célébration de cette LGV doit aussi
marquer
la détermination des élus de la région Nouvelle-Aquitaine à voir
cette ligne prolongée vers Toulouse et Dax. Mais la fête officielle
est ternie par quelques déboires juridiques.
« Pendant les années que dureront le chantier, le bassin va être massacré »
À
peine deux jours avant l’inauguration, jeudi 29 juin, le
tribunal administratif de Bordeaux a donné raison aux opposants à
la prolongation de la LGV, annulant la déclaration d’utilité
publique (DUP) pour un tronçon petit, mais crucial en cas de
poursuite de la ligne : celui du départ au sud de Bordeaux.
« Cette décision bloque tout, se réjouit Victor
Pachon, président du Cade (Collectif des associations de défense de
l’environnement du Pays basque et du sud des Landes). Il est
nécessaire pour les deux lignes envisagées : celle vers
Bordeaux et celle vers Dax. Et sans DUP, les expulsions sont
stoppées. Cela retarde le projet. »
Les
opposants sont d’autant plus satisfaits que le tribunal a repris
leurs arguments, notant la faiblesse du plan de financement.
« L’insuffisance
dont se trouve ainsi entachée l’évaluation économique et sociale
a eu pour effet de nuire à l’information complète de la
population »,
est-il écrit dans la décision. Les élus qui défendent le projet,
notamment Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ont
tout de suite fait savoir
qu’ils feraient appel et indiquent que l’argument financier ne
tiendra pas longtemps, une étude sur « les
modes de financement innovants »
étant en cours.
Pas
de quoi faire trembler les opposants. « Plusieurs dizaines
de recours de diverses associations, élus, ou communautés de
communes contre le projet sont à venir, et beaucoup s’appuient sur
pratiquement les mêmes motifs que ceux qui ont été repris par le
tribunal administratif », assure Victor Pachon.
Comme
le
racontait déjà Reporterre
en 2015,
ce projet de prolongement de la LGV au sud de Bordeaux a rassemblé
des milliers d’avis défavorables de citoyens, riverains, élus,
entrepreneurs, lors de l’enquête publique. Ils dénoncent d’abord
le budget énorme de 9,5 milliards d’euros, dont le
financement n’est pas encore trouvé, et qui risque de creuser
encore la dette du groupe SNCF au détriment des investissements dans
les trains de proximité. Ils s’inquiètent ensuite de l’impact
environnemental avec 4.830 hectares touchés, notamment au sein
des sites naturels les plus importants de la région : la zone
humide du bassin du Ciron (responsable du microclimat du Sauternes)
et la forêt du parc naturel régional des Landes de Gascogne.
La
chargée de mission pour Natura 2000 dans la vallée du Ciron,
Alexandra Quénu, s’inquiétait d’ailleurs à l’époque, sur
Reporterre, que « pendant les années que dureront le
chantier, le bassin va être massacré, entre les déplacements de
terre, le désherbage chimique, l’écoulement des eaux perturbé… »
« Des infractions à l’environnement… sur toute la ligne »
Une
inquiétude légitime, car c’est justement ce qu’ont constaté
les associations environnementales sur le chantier de l’un des
tronçons de LGV inauguré ce samedi. C’est le deuxième dossier
susceptible de gâcher la fête. France nature environnement, ainsi
qu’une association locale, la Sepant (Société d’étude, de
protection et d’aménagement de la nature en Touraine), ont annoncé
cette semaine qu’elles assignaient en justice pour réparation,
auprès du TGI de Nanterre, les sociétés Cosea et DTP. Ces filiales
de Vinci et de Bouygues construction ont participé au chantier des
LGV mises en service ce weekend. Et les associations affirment
y avoir relevé « des
infractions à l’environnement… sur toute la ligne ».
Elles
pointent notamment, en Indre-et-Loire, les rejets « dans les
rivières des eaux polluées sans les assainir ». Des
pollutions et d’autres infractions environnementales auraient aussi
été constatées en Charente et en Gironde. Par ailleurs, les
organisations remarquent « un retard important dans la
réalisation des mesures devant compenser les atteintes
environnementales non évitables. (…) Seuls 43 % de
surfaces compensatoires environnementales seraient aujourd’hui
validées par l’Etat, alors que la mise en œuvre des mesures
compensatoires devait être terminée au 1er juillet 2017. »
Les
porteurs du projet annonçaient pourtant, il
y a quelques mois,
800 « ouvrages
pour la faune » et
3.500 hectares de terres peu à peu mobilisés pour la
compensation des hectares naturels détruits par l’ouvrage.
Sur
tous ces sujets, les opposants aux LGV ont décidé, pour se faire
entendre, de faire eux aussi la fête ce samedi. Une « réponse
au battage médiatique autour de l’inauguration »
des nouvelles lignes. Un rassemblement a lieu jusqu’à
ce soir à Pompéjac (Gironde).
Les cheminots, de leur côté, appellent à manifester ce samedi
également, dénonçant la privatisation du service public : la
ligne Sud-Est Atlantique est en effet la première LGV exploitée via
un partenariat-public-privé, conclu avec Vinci.
►Bure
face
aux nouvelles pressions policières, on relaie l’appel
à rejoindre Bure dés maintenant et pour une grande
manifestation le 15 août.
CIGEO dégage, Résistance et Sabotage !
CIGEO dégage, Résistance et Sabotage !
►G20 à Hambourg : ville transformée en forteresse, campement interdit, manifestants pistés :
L’IRSN pointe des failles dans la sécurité du projet Cigeo de Bure
L’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a publié
vendredi 7 juillet son évaluation du dossier « d’Option
et de Sûreté du projet Cigéo ». L’IRSN y estime que le
projet y atteint « une maturité technique satisfaisante »,
mais pointe que des lacunes de sécurité : le stockage des
déchets « ne présente pas les garanties de sûreté
suffisantes ».
L’évaluation
démontre 4 lacunes : l’architecture du stockage ne
présenterait pas de garanties suffisantes pour assurer que les
rejets de radioactivité dans l’environnement restent limités. La
stratégie de surveillance du site, une fois en activité, serait à
revoir. L’Andra n’aurait pas étudié la possibilité de retirer
des « colis » de déchets accidentés, ce qui
remettrait en cause la réversibilité du stockage. Un risque
d’emballement thermique si la température venait à augmenter,
notamment en cas d’incendie, pourrait également mettre en péril
l’installation.
Pour
le Réseau Sortir du nucléaire, ce rapport est la preuve qu’« il
est irresponsable pour prétendre assurer un exutoire à la filière
nucléaire, de présenter le projet Cigéo comme inéluctable alors
que les garanties de sûreté ne sont pas au rendez-vous et ne
pourront jamais être apportées ».
- Sources :. IRSN . Sortir du nucléaire sur Reporterre
►Hambourg : # NO -G20
La SNCF, collaboratrice de l’Etat Policier ! : SUD-Rail a publié un communiqué montrant que la SNCF demande au cheminots de pister les zadistes dans les trains à l’occasion du G20 à Hambourg. Pour avoir des infos des mobilisations (et répressions) qui se passent là-bas, voir sur nantes.indymedia, nog20fr.noblogs.org et aussi là
À Hambourg, la société civile conteste le sommet du G20 et le néo-libéralisme :
A Hambourg, au cœur du contre-G20
La
réunion du G20 a commencé officiellement vendredi matin à
Hambourg. Dès la veille, les opposants ont donné de la voix. La
tension est encore montée d'un cran vendredi, avec une
multiplication d'actions, de manifestations et de blocages, la
plupart du temps menés par des membres de la gauche radicale, qui a
débordé les forces de l'ordre. Reportage.
Hambourg
(Allemagne), envoyés spéciaux.–
Au deuxième jour de grosses mobilisations contre la tenue du G20 à Hambourg, en Allemagne, et alors que les leaders des 20 pays commençaient à se réunir, la police locale a fini vendredi par demander du renfort. En cause : son débordement, le matin même, alors que les manifestations et blocages se multipliaient dans toute la ville. Le quartier d’Altona, à l’ouest, a été le plus touché (lire notre Boîte noire). Un rassemblement, annoncé la veille, a eu lieu à 7 heures du matin. Plusieurs centaines de manifestants vêtus de noir et masqués ont semble-t-il rapidement débordé les forces de l’ordre, se retrouvant à marcher seuls dans la rue. Selon un premier bilan, une vingtaine de voitures ont été incendiées et des commerces attaqués.
Interrogé sur le sujet, Andreas Beuth, avocat et représentant légal de la Rote Flora, le plus gros squat de la ville de Hambourg, se dit « évidemment contre le fait que des biens de résidents soient détruits » mais insiste sur le fait que « ces petits groupes n’ont rien à voir » avec les manifestations imaginées par les organisateurs. Il est douteux que ses propos convainquent la police hambourgeoise, qui a fait savoir en début d’après-midi qu’elle allait recevoir le renfort de 200 officiers de Bade-Wurtemberg, 200 autres de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et 300 de Berlin.
 |
|
L'une des manifestations (« Queer Feminist
Revolution ») vendredi matin à Hambourg, dispersée par la police ©
Yann Levy / Hans Lucas
|
Un quartier symbolique pour l'extrême gauche
Ces victoires sont certes symboliques, mais elles n’en demeurent pas moins un retournement de situation après une série de grands événements si fermés que les manifestants s’étaient à peine fait entendre – comme par exemple le G20 d’Antalya, en Turquie, en 2015, le G7 de Taormine, en Italie, en 2017. Le fait qu’il se tienne à Hambourg, en plein centre-ville, n’est d’ailleurs pas sans poser question. Car la ville est réputée pour compter un grand nombre d’anarchistes et de membres du Black Bloc – certains considèrent même qu’il s’agit du plus important d’Allemagne. Des manifestants avancent des hypothèses sans jamais conclure : « Je pense que c’est pour montrer que c’est possible », dit l’un ; « Certains pensent que c’est aussi parce que le maire est SPD et que Merkel voulait l’embêter », avance un autre ; « Il y a eu un deal entre Berlin et Hambourg, le premier visant les Jeux olympiques et le second le G20 », croit savoir un troisième.
Le lieu de la réunion des vingt puissances se trouve à quelques centaines de mètres du quartier de Sankt Pauli, haut lieu de l’anarchisme et du mouvement autonome local. Et ce depuis longtemps. En bordure de l’Elbe, le quartier était en effet à la frontière entre le Danemark et la Prusse jusqu’au XIXe siècle. Un mélange de commerce, de prostitution et, déjà, d’idées libertaires.
Le quartier est à présent surtout connu pour son stade et son équipe de foot, le FC Sankt Pauli. Le club existe depuis 1910, mais c’est dans les années 80 qu’il gagne ses lettres de noblesse. Et pas sur le terrain. Dégoûtés par la tournure raciste et hooliganiste de l’autre club de la ville, le Hambourg SV, les habitants, de gauche, du quartier – entre autres connu pour ses squats à l’époque – commencent à investir ce club. Dans les années 90, le club se dote d’une « constitution » qui le définit comme « féministe, anti-homophobie, antifasciste et antiraciste », explique Jan, supporteur et graphiste pour le club. « C’était révolutionnaire pour un stade », insiste le jeune homme, qui lui-même a été à son premier match à 7 ans, en 1993.
Vers 16 heures jeudi, l’enfer semblait pourtant bien loin. Au niveau du marché aux poissons, la large avenue St. Pauli Fischmarkt remonte légèrement en s’éloignant du fleuve. C’est ici que les organisateurs de la manifestation « Welcome to hell » avaient dressé une scène pour des concerts, deux cahutes pour distribuer à boire et à manger, ainsi que divers points d’information. En milieu d’après-midi, alors que le soleil tape dur, quelques milliers de personnes y convergent, cherchant une place à l’ombre des immeubles ou des arbres. Non loin, une dizaine de fourgons de police sont déjà stationnés, tandis qu’on aperçoit, de l’autre côté de l’Elbe, un énorme affichage du port de Hambourg : « Keep Global Trade Open ». Et plus loin encore derrière, des grues métalliques à l’arrêt qui ressemblent à leurs homonymes à plume.
Il y a là des punks, des anarchistes, des altermondialistes, des vieux et des jeunes, des porteurs de dreadlocks ou de jeunes intellos à lunettes, chemisette et sage raie sur le côté. Un père accompagne ses fils, adolescents, une femme berce son bébé en poussette à côté d’un iroquois à crête multicolore. Quartier oblige, on trouve une quantité impressionnante de tee-shirts, sweat-shirts, drapeaux Sankt Pauli, dont l’emblème est celui des pirates, le fameux Jolly Roger. Ça parle allemand bien sûr, en grande majorité, mais aussi anglais, français – un peu –, italien, grec, espagnol et d’autres langues slaves.
Grand gaillard aux yeux bleus, légère barbe en bataille sous le menton, Christian* est allemand, membre d’un groupe présent dans trente villes en Allemagne. Ils font des actions illégales « mais préviennent toujours auparavant », sur le modèle de la désobéissance civile. Il ne se qualifie pas d’autonome, car son groupe est plus ouvert, avec des anarchistes, des léninistes, etc. « On se dit non dogmatiques et on essaye de s’organiser avec tous ceux qui peuvent aider. » « On est anticapitalistes, mais on ne pense pas que le parlementarisme soit foncièrement mauvais », ajoute-t-il, avant de préciser : « La gauche est très faible aujourd’hui en Allemagne, donc on est forcés de s’ouvrir. » Il a passé une tête à Nuit debout, connaît certains slogans des manifestations contre la loi sur le travail.
Alors que l’heure du départ en manifestation approche, Jan, le graphiste du FC Sankt Pauli, précise n’avoir jamais vu autant de policiers à Hambourg. L’itinéraire de la manifestation semble à première vue faire une double boucle compliquée : il suit en fait le périmètre de la fameuse zone bleue, qui doit prendre effet le lendemain matin.
« Nous sommes horrifiés et inquiets »
Vers 19 heures, les premiers groupes de manifestants sont déjà en ordre de marche à l’avant du cortège. Un bon millier de personnes se retrouvent derrière plusieurs banderoles – « Smash G20 – Welcome to hell », « G20 Welcome to hell », etc. Tous ou presque sont vêtus de noir des pieds à la tête (casquettes et lunettes de soleil, voire cagoules). Derrière, plusieurs milliers de personnes se massent en attendant le départ, un camion prend place au milieu de la manif avec ce slogan : « We are fucking angry. » Beaucoup de photographes et cameramen sont à pied d’œuvre, dont certains ont déjà leur casque – ce qui est un peu ridicule, surtout sous un soleil de plomb.Mais le départ ne vient pas. On aperçoit régulièrement l’un des organisateurs faire des allers-retours entre la tête de cortège et le premier cordon de police, avant de comprendre que cette dernière exige que les manifestants retirent tout ce qui pourrait leur masquer le visage. Plusieurs hélicoptères tournoient au-dessus de l’Elbe.
25 minutes passent. Et tout à coup, les policiers chargent par le côté la tête du cortège, bloquant la plupart des gens contre un mur d’environ deux mètres qui mène à une promenade piétonne longeant la rivière. Certains manifestants, aidés par d’autres déjà sur la promenade, parviennent à escalader. D’autres ont moins de chance et retombent lourdement sur la rue. Depuis le promontoire, commencent à jaillir canettes et bouteilles vides sur la police. Le chaos est général en quelques instants.
Manifestants et policiers courent dans tous les sens, certains tentent de gagner les rues perpendiculaires, d’autres descendent sur le quai. Les escadrons des forces de l’ordre les repoussent de toute part, subissant de leur côté des jets incessants de projectiles. Il ne faut pas quelques minutes avant que les canons à eau se mettent en action, ajoutant du chaos au chaos. On croise un jeune garçon le visage couvert de sang après une plaie au crâne. Pendant près d’une heure, les mêmes scènes vont se répéter, déplaçant à chaque fois de petits groupes de manifestants vers les rues étroites de Sankt Pauli. On peut voir un groupe en noir passer en courant dans un sens, un groupe de policiers passer dans le même sens juste après, puis d’autres manifestants courant dans le sens contraire quelques secondes plus tard.
Une cinquantaine de personnes sont repoussées sans ménagement par des policiers dans un escalier, obligées de le monter tant bien que mal. Dix minutes plus tard, ce sont les policiers qui redescendent les marches quatre à quatre, sous un flux de canettes et de feux d’artifice. En haut, des street medics évacuent un jeune salement amoché, la jambe sanguinolente. 14 personnes se trouvaient à l’hôpital vendredi midi, selon une membre de la Legal Team, dont trois dans un « état critique ».
La manifestation est fichue, éparpillée. « Nous sommes horrifiés et inquiets de l’approche de la police », déclare Christoph Klein, membre de la G20 Platform à l’origine de la manifestation. « Des gens auraient pu se blesser en escaladant le mur, d’autres auraient pu tomber dans la rivière, poussés par la police. » « Nos droits fondamentaux ont été bafoués au nom de Trump et d’Erdogan », conclut-il. Un autre organisateur est tout aussi indigné : « L’escalade a été causée par la police, c’est évident. »
Mais les manifestants n’ont pas dit leur dernier mot. Deux cortèges sauvages partent dans Sankt Pauli en début de soirée, se rejoignent un peu plus tard. La nuit tombe, tout le quartier est assailli d’opposants au G20 et la présence policière, visible et massive, achève de dresser le tableau. Vers 23 heures, devant le Rote Flora, squat historique de Sankt Pauli, un grand feu de poubelles et de palettes achève de donner des airs de fête païenne. La police intervient rudement pour dégager tout le monde. Les canons à eau éteignent tout autant le feu que l’ardeur des derniers présents.
 |
|
Les canons à eau interviennent devant le Rote Flora
© Yann Levy / Hans Lucas
|
Les divers campements de la ville se remplissent. Des églises, des stades, un théâtre ont ouvert leurs portes aux anti-G20, alors que la ville a tout fait pour les empêcher de camper. Les prochaines actions n’ont lieu que dans quelques heures.
La manifestation de samedi promet à la fois d’être plus calme et plus rassembleuse, avec son intitulé « Solidarité sans frontières ». Mais pas question pour le mouvement de s’entredéchirer après ces dernières 24 heures. « Demain on arrivera tous ensemble à la grande manifestation internationale. Personne ne sera laissé en arrière », insiste Christoph Klein, de la G20 Platform. Il ajoute : « Aux gens qui ont peur, je dis, laissez la peur chez vous et rejoignez-nous »
Christophe
Gueugneau et Yann Levy (photos) - Médiapart
Et
des vidéos :
#NoG20 @ HAMBURG • DAY1 : CAMP ELBPARK – 3 juillet
https://youtu.be/ugwsNQq9Aso
(Taranis news)
#NoG20 @ HAMBURG • DAY1 : PROTEST WELLE – 3 juillet
https://youtu.be/_rzaeKpO5Ew
(Taranis news)
#NOG20 @ HAMBURG • DAY3 : RECLAIM THE STREETS – 5 juillet
https://youtu.be/xgVkqF6XifY
(Taranis news)
#NoG20 @ HAMBURG • DAY4 : « RATHER DANCE PLENTY THAN G20 » - 6 juillet
https://youtu.be/mrT--Id8QkQ
(Taranis news) ☺
#NoG20 @ HAMBURG • DAY5 : « WELCOME TO HELL » - 7 juillet
#NOG20 @ #HAMBURG • DAY6 : DEMONSTRATION
#NOG20 @ #HAMBURG • DAY7 : La police charge la Rote Flora (squat culturel)
http://taranis.news/2017/07/nog20-hamburg-%e2%80%a2-day7-polizei-charge-the-roteflora/Pour aller plus loin sur la Rote Flora :
Superbe performance de zombies :
https://youtu.be/ORIDkDVjG5o
Et soudain, le Black bloc tient un quartier à Hambourg
Vendredi soir, jour de l’ouverture officielle du sommet du G20, le quartier de Schanzenviertel a connu de longues heures d’affrontements entre la police et quelques centaines d’autonomes, sous le regard, et parfois les encouragements, d’autres activistes présents.
Le Spiegel parle d’une « nuit de violence » après les affrontements de la nuit de vendredi à samedi à Hambourg, à l’occasion du rassemblement des opposants au G20. De fait, pendant près de six heures, un quartier de la ville a connu une résistance acharnée de la part de militants autonomes, pour éviter que la police ne puisse y entrer.
Après les événements de jeudi et les actions de vendredi matin (lire notre article), une manifestation était prévue sur Reeperbahn, large artère du quartier Sankt Pauli. Le cortège dispersé, ses membres se sont dirigés vers le quartier Schanzenviertel, où se trouve le squat de la gauche radicale, Rote Flora. Ici, une rue de Sankt Pauli.
Le quartier de Schanzenviertel a beau être un haut lieu de la gauche radicale allemande, il n’est qu’à quelques encablures du centre du congrès où se réunissaient les vingt chefs d’État. La police veillait donc particulièrement à ce que les manifestants ne quittent pas le quartier vers le nord.
Sur le chemin de Schanzenviertel, quelques centaines de manifestants font la fête sur fond de musique reggae – ou de L’Internationale, qui retentit une fois !
Profitant de la dislocation de la manifestation à Sankt Pauli, des groupes d'autonomes se dirigent en courant vers le quartier de Schanzenviertel, la police ne peut pas faire grand-chose dans les petites rues de la ville.
Vers 22 heures, la police tweete : « La situation est très grave. » Il lui faudra encore trois heures avant de venir à bout du rassemblement.
À l’entrée est de la rue Schulterblatt, deux barricades en flammes forment le comité d’accueil. Au loin, d’autres barricades flambent elles aussi. La rue entière en comptera une demi-dizaine durant quelques heures.
Plusieurs commerces ont été attaqués puis pillés. Et la nourriture ou les boissons distribuées dehors aux personnes présentes.
Pendant plusieurs heures, l'entrée ouest de la rue par-dessus laquelle passent des voies de chemin de fer donne lieu à des affrontements en règle : pavés contre canon à eau. Deux grands parasols d'un bar tout proche sont détournés pour permettre au Black bloc d'avancer.
Outre des cailloux ou des pavés cassés en morceaux, les autonomes jettent des fumigènes, des pétards ou des feux d'artifice sur la police.
Le Black bloc bouge en groupes de quelques individus à quelques dizaines, généralement par nationalité ou affinité. Les actions sont plus ou moins coordonnées.
Le mobilier urbain est arraché pour grossir les barricades.
À minuit, des tirs de grenade lacrymogène dispersent une première barricade, située à l’ouest de la rue. Le Black bloc quitte les lieux pour se concentrer sur l’autre barricade, à environ 300 mètres.
Peu avant une heure du matin, la police finit par déloger les derniers récalcitrants à l’aide de plusieurs canons à eau, de troupes et d’un véhicule blindé léger qui disperse les barricades.
Infos du 10 au 16 juillet
A Hambourg,
fractures au sommet et solidarité dans la rue
Le G20 officiel s'est achevé samedi avec une déclaration a minima. Du côté des opposants, le bilan se veut plus positif, en dépit des violences. « Nous avons fait ce que nous avons dit, nous avons perturbé le début du sommet », estime l’organisateur de la mobilisation « Block G20 ».
Resteront les images d’une ville en état de siège, du dispositif policier d’ampleur, des hélicoptères omniprésents jour et nuit, des images de manifestation tantôt joyeuses, tantôt violentes, de la vraie solidarité entre tous les militants anti-G20, quels que soient leurs choix de résistance.
 |
|
Le Black Bloc dans le cortège international samedi à
Hambourg © Yann Levy / Hans Lucas
|
Dans le centre des congrès, les vingt leaders des pays développés ou en voie de développement réunis à Hambourg ont tout de même accouché d’un texte, résumé comme suit par le président français Emmanuel Macron : « Il y a une avancée sur le terrorisme et le recul a été évité sur beaucoup de sujets. » Sur le terrorisme et la sécurité, le sommet a été marqué par la longue rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Deux heures et demie au cours desquelles les deux chefs d’État ont convenu de la mise en place d’un cessez-le-feu, à compter de dimanche, dans le sud-ouest de la Syrie.
Le principal recul « évité » concerne le climat. Le président américain, Donald Trump, qui a annoncé le retrait des États-Unis de l’accord de Paris (signé en décembre 2015 lors de la COP21), s’est retrouvé isolé. La déclaration finale « prend acte » de cette décision, mais qualifie dans le paragraphe suivant l’accord international d’« irréversible ». Sans les États-Unis, les dix-neuf autres pays se disent prêts à accélérer la transition énergétique.
Mais le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a jeté un froid lors de sa conférence de presse finale en insistant sur le fait que « tant que les promesses qu'on nous a faites ne seront pas respectées, nous ne pourrons pas le faire ratifier par notre Parlement ». Le président turc met ainsi la pression sur le futur fonds vert pour le climat, destiné à accompagner les pays en développement à s’adapter face au réchauffement climatique. La Turquie pourrait être considérée comme un pays industrialisé et donc se voir contributrice et non pas bénéficiaire du fonds. Emmanuel Macron a d’ores et déjà annoncé une conférence à Paris le 12 décembre prochain. Un « sommet d’étape », destiné à « prendre de nouvelles actions pour le climat, notamment sur le plan financier ». De son côté, Donald Trump affirme, dans une déclaration publiée samedi, que son pays va aider d’autres États à « avoir accès et à utiliser des énergies fossiles ».
Enfin, sur le plan économique, tout continue comme avant. Les vingt ont rappelé la nécessité de garder les marchés ouverts et le rôle de l’OMC. Dans la déclaration finale, ils s’engagent à « combattre le protectionnisme, y compris toutes les pratiques commerciales inéquitables », tout en reconnaissant « le rôle des instruments de défense commerciale légitimes dans ce but ».
Autant d’éléments qui ne peuvent que conforter les militants ayant manifesté, pendant près d’une semaine, dans les rues de Hambourg. Intervenant au FCMC, le centre de médias des anti-G20, le Dr Boga Sako, président et fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l’homme et la vie politique, a longuement dénoncé l’illégitimité de ce sommet, qui ne compte qu’un pays africain – l’Afrique du Sud. « Pourquoi l’Afrique est légitime à s’opposer à une réunion du G20 ? s’est interrogé Boga Sako. Simplement parce que la démocratie et les droits de l’homme posent problème en Afrique. » « Les dirigeants en Afrique manipulent les droits de l’homme avec la complicité des dirigeants occidentaux », a dénoncé le militant, pour qui « l’Afrique est indépendante depuis environ 50 ans, mais elle n’est toujours pas libre ».
Le choix par Angela Merkel d’organiser le G20 au cœur de la ville, à quelques centaines de mètres des quartiers de Schanze et de Sankt Pauli, bastions de la gauche radicale allemande, reste mystérieux. La ville a de fait connu plusieurs jours d’état de siège, sous un ballet permanent d’hélicoptères. Des milliers de policiers ont été mobilisés, une dizaine de canons à eau, des chevaux, des chiens, des véhicules blindés. Mais un tel déploiement n’a pas pour autant empêché les actions de militants déterminés.
« Nous avons fini d’avoir peur de la police »
Le ton a été donné en début de semaine, quand les autorités ont tenté d’empêcher les campements de militants. Jeudi 6 juillet, la grande manifestation intitulée « Welcome to hell » n’a tout simplement pas pu partir, après des charges de la police. Vendredi matin, des actions variées ont eu lieu en divers points de la ville. Le port d’Hambourg a été partiellement bloqué, la zone bleue, interdite à toute manifestation, a été violée à plusieurs endroits par des manifestations, tantôt pacifistes, tantôt sauvages (lire ici notre article). Vendredi soir, le quartier de Schanze, où se trouve le Rote Flora, squat historique de la ville, a donné lieu à une bataille rangée entre un millier de militants autonomes et autant de policiers (voir notre portfolio). La ville a dû faire appel à des forces de l’ordre supplémentaires des régions proches, allant jusqu’à faire intervenir la force USK, sorte d’élite du maintien de l’ordre établie en Bavière. |
|
Opération de police samedi soir dans le quartier de
Schanze, à proximité du squat Rote Flora © Yann Levy / Hans
Lucas
|
« Nous avons fait ce que nous avons dit, nous avons perturbé le début du sommet », estime l’organisateur de la mobilisation « Block G20 ». « Vendredi, les rues appartenaient au peuple, pas au G20, des milliers de personnes sont entrées dans la zone bleue », ajoute-t-il. Ce jour-là, dans l’après-midi, une manifestation de 10 000 personnes est parvenue à marcher vers la philharmonie, où les chefs d’État et de gouvernement assistaient à un concert. « Nous avons fini d’avoir peur de la police », conclut Nico Berg.
Le rôle joué par les forces de l’ordre a été régulièrement dénoncé par les opposants au sommet. Werner Rätz, activiste, organisateur de la manifestation de solidarité internationale du samedi, estime ainsi que « ces derniers jours ont montré que les vingt sont capables d’empêcher les gens de manifester ». Fait notable : les appels à se désolidariser des éléments violents sont restés lettre morte durant toute la mobilisation du contre-sommet. « Notre solidarité va aux participants des manifestations, les autonomes font partie de ces manifestations donc nous en sommes solidaires », a lancé Werner Rätz aux journalistes.
Dans un premier bilan, la police affirme que 147 personnes ont été arrêtées, 37 sont en prison le temps des investigations et 23 personnes sont recherchées. Samedi, les policiers ont également tenté de faire des descentes dans les différents campements d’opposants. Des Français et des Italiens étaient semble-t-il activement recherchés, sept des premiers et huit des seconds auraient été arrêtés. Près de 1 000 personnes ont à nouveau défilé à Hambourg dimanche, pour dénoncer ces arrestations. Plusieurs centaines de policiers ont été blessés. Du côté des manifestants, aucun bilan n’est défini, mais selon des membres de la Medic Team, il y aurait plusieurs centaines de blessés également.
 |
|
Vendredi matin à Hambourg, lors d'une action contre
le G20 © Yann Levy / Hans Lucas
|
Les affrontements entre police et manifestants ont connu une escalade vendredi, avant de décliner samedi. Samedi soir, une vaste opération de police dans le quartier de Schanze n’avait apparemment d’autre but que d’occuper le terrain, voire, comme le suggère un activiste sur place, « de lancer une opération de revanche par rapport à hier ».
Alors que des milliers de militants se trouvaient dans le quartier, dans les bars, les restaurants, sur les trottoirs et dans les parcs, des centaines de policiers en tenue, accompagnés de canons à eau et de véhicules blindés, ont investi vers 22 heures la rue où se trouve le Rote Flora, dispersant la foule sans rencontrer d’autre opposition que des personnes les mains en l’air, des danseurs ou des groupes assis à même la rue. « On a vu des personnes masquées et habillées en noir marcher rapidement dans la rue, sauf qu’il y avait marqué police sur leur dos », estime Gabriele Heinecke, de la Legal Team (des juristes venant en aide aux manifestants arrêtés).
Plus tôt dans la journée, la grande manifestation internationale de solidarité avait eu lieu sans aucun heurt. 70 000 manifestants selon les organisateurs, 50 000 selon la police (qui avait dans un premier temps avancé le nombre de 20 000), ont marché depuis la gare centrale jusqu’au stade Millerntor, celui du FC St. Pauli, équipe de foot qui joue en deuxième division mais dont les supporteurs sont tous de gauche. (nous en parlions ici).
 |
|
Les combattants
kurdes à l'honneur de la manifestation internationale de samedi ©
Yann Levy / Hans Lucas
|
Pendant plusieurs heures, le cortège a défilé dans les rues de la ville. Une place spéciale avait été accordée aux revendications kurdes. Un grand portrait d’Abdullah Öcalan, fondateur du parti kurde PKK, a été déployé tandis que des fanions YPJ (unité de protection des femmes au sein de l’YPG, groupe de combat issu du Parti de l’union démocratique kurde, considéré comme terroriste par les autorités turques) étaient visibles tout au long du cortège.
La présence du parti Die Linke était faible, de même que celle de l’organisation internationale Attac, pourtant fer de lance de l’altermondialisme dans les années 2000. De fait, ce sont à nouveau les forces les plus radicales qui étaient les plus nombreuses et organisées. Plusieurs centaines de personnes ont défilé sous la bannière de Interventionistische Linke, d’autres derrière un camion Welcome to hell… En revanche, certains slogans semblaient mettre tous les manifestants d’accord. On entendait ainsi, d’un bout à l’autre du cortège, « ah ah anti, anticapitaliste ». Quand bien même le capitalisme semble de nouveau avoir gagné au G20.
 |
|
Le cortège du Interventionistische Linke samedi matin
lors de la manifestation internationale à Hambourg © Yann
Levy / Hans Lucas
|
Une autre manche pourrait se jouer la semaine prochaine. Durant la mobilisation, des appels ont commencé à circuler pour perturber la visite de Donald Trump en France, à l’occasion du 14-Juillet.
christophe Gueugneau et Yann Levy (photos) - Médiapart
Infos du 10 au 16 juillet
À Bure, nouveaux risques d’expulsion,
grosse mobilisation mi-août !
Face à la pression policière, on relaie cet appel à rejoindre Bure dès maintenant et pour la manifestation du 15 août :
Depuis quelques jours, la pression policière s’intensifie à Bure. Vendredi 30 juin en fin d’après-midi 6 fourgons sont venus harceler les entrées de la forêt au nord et au sud. À vigie sud, ambiance : 30 gendarmes en lignes, boucliers, casques, observation distante à 100 m de la barricade. À barricade nord, ligne de 10 flics, et 2 gendarmes mobiles (GM) à genoux, flashball sortis, dans un fourré face à la barricade. Repli général vers 18h30 – 19h. Même chanson samedi 1er juillet, 4 fourgons à la vigie sud, une ligne de 15 GM, barricade enflammée. Et dans les villages tout autour, contrôles au faciès, vérifications d’identité au commissariat, raccompagnement à la Maison de la résistance par les GM, pression sur des riverains du coin, course-poursuite à travers champs et interpellations avec armes sorties… Une stratégie de harcèlement d’une nouvelle intensité s’est mise en place depuis la semaine d’action de fin juin – ce n’est jamais monté à un tel niveau, y compris pendant l’été 2016.
Depuis quelques semaines, 70 GM ont élu domicile dans le laboratoire. « On est là pour longtemps, et on va se revoir » haranguent-ils d’un petit air satisfait. Gérard Longuet et ses sbires font du cirage de pompes au Premier Ministre pour le supplier de rouvrir une nouvelle gendarmerie à Montiers-sur-Saulx en agitant, une fois n’est pas coutume, le hochet des méchants cagoulés-terroristes qui harcèleraient la « population locale ». Les policiers eux-mêmes se plaignent d’un manque d’action. Cette stratégie de la tension ressemble avant tout à une opération psychologique : elle cherche à nous faire déraper et nous épuiser.
Oui, ces harcèlements nous mettent en (n/r)age, nous étouffent, nous font penser qu’ils peuvent tenter d’expulser ou détruire les constructions de la forêt d’un moment à l’autre – même si l’Andra s’est à nouveau pris une claque juridique le 28 juin et doit recommencer toutes ses procédures pour obtenir l’autorisation des défrichements et des forages. Oui, nous sommes fragiles, vivant-e-s, vagues émotives. Mais nous ne nous enfermerons pas dans le rôle qu’ils attendent de nous, la caricature des « radicaux-ultra-violent.es » traqué.es de toutes parts. Ils ne nous paralyseront pas, parce que ce qui nous tient à Bure est trop important – rencontres jardins fêtes coups de mains débrouille bidouille cantines massages ennui lumière du soir entrelacs de nuage rivière discussions cabanes histoire possibles présent etc etc – pour se laisser désarçonner par ce nouveau stade de pression. Malgré leurs innombrables tentatives de division, tout le mouvement de lutte rappelle qu’« il est vain de vouloir caricaturer l’opposition à Cigéo ». On ne nous empêchera pas de continuer à rire, vivre, danser, et nous organiser. Car ce que la Préfecture ne semble toujours pas comprendre c’est que cette stratégie de la tension peut produire l’effet inverse de celui d’escompté, à savoir un surcroît de solidarité.
La meilleure manière de réagir à cette stratégie de la tension est d’affirmer notre plaisir d’être ensemble. Nous invitons, comme toujours, à venir faire un tour à Bure dés maintenant pour nidifier dans la forêt. Et nous appelons à une grande manifestation le 15 août, à 14h à Bure, qui suivra le festival des Bure’lesques du 11 au 13 août entre Couverpuis et Biencourt ! Rassemblons-nous massivement dans le village de Bure pour poursuivre ce magnifique pied-de-nez à leur sordide désert flico-irradié. Ramenez votre repas à partager et de quoi cueillir vos champignons atomiques !
Le 14 août 2016, nous avons mis à terre le mur de la honte de l’Andra. Le 18 février 2017, nous avons ébréché quelques grillages au cœur même du laboratoire de l’agence – et montré que le projet qu’elle sert, et le système qui la sous-tend, n’étaient pas intouchables. Ces actions magnifiques ne sont pas éphémères, elles naissent de l’élaboration quotidienne d’une communauté de vie et de lutte joyeuse et émancipatrice, dans laquelle chacun-e peut trouver une place, se réinventer, s’auto-organiser. Que va-t-il donc se passer le 15 août 2017 ? Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura de la joie, une envie de se tenir ensemble et faire attention les un-e-s aux autres.
Face à la pression policière et aux risques d’expulsion, gardons le cap, tenons l’agenda, profitons de l’été ! — — —
* Dès maintenant :
Vous pouvez suivre l’actualité sur le Fil info, sur FB (Bure a cuire) et twitter (@ZIRAdies) La Maison de Résistance et la Forêt libérée vous accueillent quand vous voulez pour participer à la vie sur place, surveiller la maréchaussée, arroser les jardins et boire du jus de pomme au soleil !
* En cas d’expulsion
RDV le jour même à 18h à la maison de Résistance Convergence vers Bure dans les jours qui suivent Manif de réoccup dans les semaines qui suivent Appel à actions décentralisées contre les promoteurs et sous-traitants de la poubelle nucléaire : Vinci, Eiffage, Edf, Andra, Areva, le CEA…
L’affiche et le tract, à diffuser largement !
* pour un mois d’août inoubliable…
* Début août, la préparation des Burelesques et des ateliers queer féministes non-mixtes à Bure !
* Du 11 au 13, le festival Les Burelesques. Toutes les infos sur burefestival.org. Inscription à la newsletter en envoyant un mail vide à burelesques_info-subscribe@lists.riseup.net.
* Le 15 août : grande manifestation anti-cigéo au départ de Bure. Info à venir très prochainement !
Nouveaux doutes sur le stockage
des déchets nucléaires à Bure
Le centre d’enfouissement des déchets nucléaires Cigéo, qui doit ouvrir en 2025, n’offre pas à ce stade de « démonstration de sûreté probante » pour quatre points majeurs de son fonctionnement, analysent dans une note récente les experts de l’IRSN. Ce projet est « caduc », alerte l’ingénieur agronome Bertrand Thuillier, tandis que l’agence chargée du site attend l’avis de l’Autorité de sûreté.
En ce début d’été 2017, le système nucléaire se retrouve mis sous pression de tous les côtés : pour la première fois, le gouvernement chiffre à 17 le nombre de réacteurs à fermer pour respecter l’objectif de 50 % en 2025. Le coût des EPR ne cesse de s’alourdir et leur date de mise en service d'être reculée. Et c’est maintenant le Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), dont l'ouverture est prévue en 2025 à Bure (Meuse), qui fait l’objet d’une note de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), l’expert public sur les risques de l’atome, mettant en cause une partie de sa conception. Dans un avis du 15 juin, publié vendredi dernier (à lire ici), les spécialistes, qui ont étudié le projet de stockage des déchets nucléaires, rendent publiques des lacunes importantes concernant la sûreté de la future installation : « La possibilité d’aboutir à une démonstration de sûreté probante à cette échéance pose encore question pour quatre points majeurs qui pourraient entraîner des modifications substantielles de la conception du stockage », écrivent-ils. Mais « la maturité technique » du projet est « satisfaisante » à leurs yeux. Et ils soulignent les efforts de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) dans la constitution du dossier technique sur la sécurité de l’installation.
Tout, dans Cigéo, de sa taille gigantesque à ses horizons temporels, évoque la science-fiction. L’Andra, opérateur du projet, s’interroge ouvertement quant à la manière de communiquer sur la nature du site avec les Terrien.ne.s qui s’en approcheront dans plusieurs millénaires. Cette approche peut susciter un fascinant vertige et une ivresse mégalomaniaque. Au point d’occulter les lourds enjeux industriels de la construction et de l’exploitation du centre.
C’est ce retour sur terre, empirique et technique, qu’opèrent les experts de l’IRSN. Plusieurs problèmes sont identifiés.
Quand Cigéo entrera en fonction, les colis de déchets commenceront à y être entreposés alors même que se poursuivra la construction du site souterrain. L’ouvrage s’annonce dantesque : comme le sol de Bure est argileux, il contient de l’eau et est friable. Les galeries devront donc être soutenues par de gigantesques structures métalliques. Ces travaux seront particulièrement difficiles à conduire à plusieurs centaines de mètres sous la terre. Pour l’IRSN, « l’optimisation de l’architecture du stockage du point de vue de la sûreté » doit être améliorée. Ils considèrent aussi « qu’il n’est pas acquis que la conception retenue par l’Andra permette d’exercer, pendant la phase d’exploitation, une surveillance adaptée aux enjeux particuliers posés par la maîtrise des risques associés au stockage ».
Parmi les divers déchets stockés à Cigéo, on trouvera des boues radioactives contenant l’eau contaminée issue des sites de retraitement de La Hague et de Marcoule. Elles doivent être enfermées dans des colis bitumineux. Le problème, c’est que ce type d’emballage s’enflamme très facilement. Or, le risque d'incendie est réel. Pourquoi ? La terre argileuse dans laquelle sera creusé Cigéo est saturée d’eau. Les colis de déchets laisseront passer de la radioactivité. Soumise à des rayonnements ionisants, la molécule de l'eau se transforme et produit de l'hydrogène. Ce gaz, mobile et explosif, pourrait s'enflammer en cas de dysfonctionnement de batteries ou d’appareil électrique. Il est prévu qu’il soit évacué du centre par un système de ventilation. Mais que se passerait-il en cas de panne ? Le problème est d'autant plus sérieux que les colis de déchets, enfoncés dans de longs tunnels irradiants, seront inaccessibles. L’architecture souterraine de Cigéo doit donc trouver une solution au problème de l'inflammation possible de l’hydrogène. Car il y a plus : son rejet par les colis risque non seulement de traverser les bouchons des alvéoles, mais aussi de les dégrader et de menacer l’étanchéité du site.
« La possibilité de retrait des colis accidentés avec des moyens définis dès la conception n’a pas été étudiée », alerte l’IRSN, qui en tire la conclusion que « la conception actuelle du stockage ne permet pas le stockage sûr des déchets bitumineux ». Les experts de l'institut demandent également que l'aléa sismique soit étudié plus en détail.
L’Andra va donc devoir apporter, « dans les meilleurs délais », de nouveaux éléments afin de décider si le procédé est valable ou non.
« Un délire irréaliste »
« Toutes ces questions appellent nécessairement une réponse », insiste l’IRSN, dans le futur dossier de demande d’autorisation de création (DAC), qui doit enclencher le processus de construction de Cigéo. Signe de la complexité des enjeux soulevés et de la difficulté à les régler, les experts prennent la peine de préciser, à la fin de leur avis, qu’ils « ne présagent pas des délais nécessaires pour réunir ces éléments de démonstration et en conséquence de l’échéance à laquelle le dossier de DAC pourra in fine être achevé ».
« C’est une note très importante car elle montre que les problèmes de sûreté sont liés à la conception même de Cigéo et aux choix initiaux de ceux qui ont développé cette idée. Les risques sont structurels », explique l'ingénieur agronome Bertrand Thuillier, qui critique depuis des années ce projet d’enfouissement. Il considère que dans sa conception de Cigéo, l’Andra a commis des « fautes graves », et que le projet « est caduc » : « Soit on change complètement de conception et, au lieu de construire un site énorme, on prévoit de petites unités, mais il faut tout repenser alors qu’un milliard d’euros a déjà été investi. Soit on n’y enfouit pas les colis bitumineux. »
Mais que faire alors de cette énorme masse de déchets, qui représente 18 % du nombre total de colis ? Sachant qu’environ 20 % des colis ont un contenu non précisément identifié et ne sont donc pas prévus dans Cigéo, et que les combustibles usés des centrales nucléaires, les fameuses barres d’uranium, n’y sont pas non plus attendus, quelle est l’utilité réelle du site d’enfouissement ?
 |
|
Dans le bois Lejuc, occupé par des opposant.e.s à
Cigéo. (©JL)
|
Mais l’agence ne répond pas sur le fond au problème des colis bitumineux : « La question n'est pas nouvelle et a déjà fait l'objet de demandes d'études à l’Andra, au CEA, EDF et AREVA par le ministère et l'ASN dans le Plan national de gestion des matières radiocatives, sorti en 2016. Il faudra, d'ici au dépôt de DAC, poursuivre les travaux sur la conception du centre de stockage d'une part, et sur les possibilités de prétraitement d'autre part. » L’agence dit attendre prochainement l'avis du groupe d'experts et la position finale de l'ASN. « Ces dossiers ont tout d’abord été examinés par une revue internationale de pairs mandatée par l’ASN et pilotée par l’AIEA [l'Agence internationale de l'énergie atomique – ndlr], qui a émis un avis en novembre 2016 et qui soulignait que “le contenu du dossier d’option de sûreté et les discussions engagées au cours de la mission ont donné à l'équipe de revue une assurance raisonnable quant à la robustesse du concept de stockage”. » Pendant son instruction, l’IRSN a posé plus de 600 questions à l’Andra et organisé des réunions avec des parties prenantes : comités locaux d'information (CLIS), Association nationale des comités et commissions locales d'information (Anccli), membres de la conférence de citoyens organisée au moment du débat public.
Pour le Réseau Sortir du nucléaire, l’avis de l’IRSN « met l’accent sur d’importants problèmes de sûreté qui ne constituent que la partie émergée de l’iceberg. Ceux-ci avaient été dénoncés depuis longtemps par les associations et plusieurs experts indépendants. Plutôt que de s’entêter dans cette impasse, les pouvoirs publics doivent abandonner ce projet dangereux, ruineux et antidémocratique ». Pour le collectif Bure Stop, « la filière électronucléaire a imposé un délire irréaliste, l’Andra a fait un beau dessin. La suite ne saura résister grandeur nature à de multiples aléas. L’absurdité du projet est parfaitement connue en haut lieu. Alors ? Il est gravissime, de la part des pouvoirs publics, de continuer à masquer la vérité en tentant de mettre un couvercle sur une future catastrophe technologique, financière, environnementale et éthique ».
La note de l’IRSN sort alors que l’autorité environnementale vient de demander une étude d’impact à l’Andra avant de défricher le bois Lejuc. C’est dans cette forêt que l’agence souhaitait démarrer ses travaux en procédant à des fouilles pour étudier le sol. Elle est aujourd’hui occupée par plusieurs dizaines d’opposant.e.s à Cigéo. Ils y organisent, mi-août, un festival et une manifestation. Tous ces événements vont finir par retarder la procédure d’autorisation administrative du projet d’enfouissement.
Jade Lindgaard – Médiapart
Infos du 17 au 23 juillet
►GCO « Notre détermination agace... »
En Alsace, les opposants au projet Vinci d’une autoroute à péage (GCO) font face à des actes violents de la part de partisans du projet visiblement agacé par leur résistance. Depuis quelques semaines, plusieurs actes de dégradations ont été constaté notamment sur la cabane de Duppigheim (sud du tracé). Le dernier acte récent s’est produit dans la nuit du 14 au 15 juillet avec la destruction de la cabane anti-GCO de Stutzheim-Offenheim.
En tout état de cause, cet agacement montre que c’est nous qui avons raison et que la violence qu’on aimerait bien nous coller sur le dos est dans le camp des perdants... VINCI est son monde, nous n’en voulons pas !
Des opposants
Coup
d’arrêt au projet de centre commercial
Val Tolosa à Toulouse
C’est un nouveau coup d’arrêt au projet de centre commercial Val Tolosa, projeté à horizon 2019-2020 sur la zone de la Ménude, à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Et une victoire pour les associations qui mènent une bataille juridique depuis 10 ans contre le projet.
L’annulation du permis de construire avait prononcée en appel en juin 2016 et l’annulation de l’autorisation du cinéma multiplexe en mai 2017. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé, jeudi 13 juillet, l’annulation de l’autorisation de destruction d’espèces protégées et de leur habitat, délivrée le 29 août 2013 par le préfet de Haute-Garonne.
La cour déclare notamment dans ses attendus que Val Tolosa va à l’encontre du SCoT, le document qui définit la politique publique d’aménagement de l’agglomération toulousaine. « Le plateau de la Ménude (...) ne dispose pas de desserte par des voiries principales, ni par des modes de transports collectifs tels que le métro, le tramway ou le train », relève la Cour.
La Cour confirme également que l’intérêt économique et social du projet n’est pas sérieusement démontré. « En dépit de la création de plus de 1.500 emplois qu’il pourrait engendrer, ce projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur », note la Cour.
Enfin, elle affirme que le projet n’est « pas soutenu par l’ensemble des acteurs institutionnels locaux ». « Le conseil départemental a estimé que ce projet se fondait sur des études obsolètes remontant à 2005 et qu’il ne répondait plus désormais aux besoins des consommateurs », note la Cour. « Le comité syndical du syndicat mixte d’études de l’agglomération toulousaine a également émis un avis défavorable au projet, compte tenu des risques qu’il présenterait pour le commerce de proximité, les centres urbains et la saturation du réseau routier qu’il pourrait engendrer. »
Sans autorisation de destruction d’espèces, les promoteurs du projet doivent revoir leur copie. Un nouveau permis de construire, délivré en août 2016, est en outre attaqué par les détracteurs du projet. « Ce coup d’arrêt est plus important encore que sa première lecture, a réagi Pascal Barbier, du collectif « Non à Val Tolosa ». En effet, il confirme les arguments que nous présentons à cette même cour de Bordeaux pour lui demander l’annulation du nouveau permis de construire ».
Source : La Dépêche sur Reporterre
La demande d’autorisation de création de Cigéo repoussée à 2019
« Nous prévoyons désormais de déposer la demande d’autorisation de création de Cigéo mi-2019, a informé M. Abadie. Nous nous donnons douze mois de plus car, à mi-chemin de l’avant-projet détaillé, nous demandons à nos ingénieurs et aux bureaux d’ingénierie d’intégrer les variantes étudiées et les améliorations réalisées au cours des derniers mois. Il ne s’agit pas d’un report lié à l’avis de l’IRSN, mais d’un choix d’approfondissement du projet, permettant des économies substantielles avec la même exigence de sûreté. »
Vendredi 7 juillet, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) avait publié son évaluation du dossier « d’Option et de Sûreté du projet Cigéo ». Il y estimait que le projet avait atteint « une maturité technique satisfaisante », mais pointait des lacunes de sécurité : le stockage des déchets « ne [présentait] pas les garanties de sûreté suffisantes », notamment en ce qui concerne les déchets bitumineux (boues issues du traitement du combustible placées dans un enrobage de bitume, pour la plupart entreposées sur le site de Marcoule dans le Gard).
« Le sujet est identifié de longue date mais il relève d’abord de la filière nucléaire, c’est-à-dire des producteurs de déchets eux-mêmes », a répliqué M. Abadie dans cette interview. « Deux options sont possibles : pour l’Andra, optimiser les dispositifs de stockage de ces déchets pour se prémunir contre le risque d’incendie, ou, pour les producteurs, définir un procédé permettant de neutraliser la réactivité thermique des enrobés, par vitrification par exemple. Nous allons travailler sur ces deux voies pour retenir la meilleure stratégie dans le projet, tel que nous le présenterons dans la demande d’autorisation de création adressée à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui sera décisionnaire. »
Source : Le Monde sur Reporterre
La ministre des transports Elisabeth Borne :
« On fait une pause sur le Lyon Turin »
Le projet ferroviaire Lyon Turin entre « en pause » : c’est ce qu’a déclaré à Reporterre Elisabeth Borne, la ministre des Transports.
Cette pause entre dans le cadre du ré-examen des projets d’infrastructures ferroviaires décidé par le président de la République.
A l’issue de la conférence de presse durant laquelle Nicolas Hulot a annoncé le 6 juillet le plan Climat du gouvernement, Reporterre a interrogé la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à propos du Lyon Turin. Elle a confirmé que ce projet vivement contesté était mis « en pause ». Il reste maintenant à mettre concrètement en oeuvre cette pause, alors que le chantier du projet ferroviaire avance très difficilement. La ministre est auditionnée ce 20 juillet par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.
Reporterre - Sur le Lyon Turin, quand le ministre dit, "On va faire une pause et on examinera cas pas cas", ça veut dire quoi, une pause pour examiner le Lyon Turin ?
Elisabeth Borne - Le président de la République vient d’annoncer que, dès lors que les engagements qui ont été pris et les besoins incontournables en termes d’entretien et de regénération dépassent de dix milliards les recettes prévisibles à ce stade, nous sommes obligés de faire une pause pour réfléchir au modèle de mobilité et prioriser les projets. Et ensuite, on va aller vers une loi de programmation dans laquelle on ne sera plus dans des promessses non financées, on aura année par année, avec une vision sur dix ans et pendant les cinq ans du quinquennat, des dépenses et des recettes équilibrées.
Ça veut dire que pour l’instant, le Lyon Turin qui engage financièrement le gouvernement français, on fait la pause jusqu’à ce que ce processus soit mis en oeuvre ?
Le président a annoncé une démarche globale. On fait une pause, on ré-examine les orientations en termes de mobilité, on ré-examine les dépenses et les ressources pour ne plus faire de promesses pas financées, et avoir des ressources cohérentes avec les promesses qu’on a faites.
Je suis un peu bête, mais c’est une pause sur le Lyon Turin ?
C’est une pause.
Ecouter l’entretien : https://youtu.be/eXCffvhOTi4
Entretien avec Elisabeth Borne - Reporterre
►Appel international pour une mobilisation à défendre la forêt de Hambach : depuis 5 ans le site est occupé pour lutter contre un projet dégueulasse d’extraction à ciel ouvert. Malgré la répression les copin.e.s sur place résistent encore !
À partir de Septembre ateliers dans la forêt qui donneront à tous les outils pour être actifs au sein et autour d’Hambi. Nous passerons au travers de toutes les habilités nécessaires à occuper un arbre et entreprendre d’autres actions.
À partir d’Octobre occupation à grande échelle de la forêt, rendant impossible à RWE de continuer à couper l’espace restant.
Si vous ne pouvez vous rendre à la forêt, aidez nous et vous-mêmes de là où vous êtes. Aider nous à répandre cet appel, exprimez votre solidarité au mouvement de résistance à Rhineland, et n’hésitez pas à passer nous voir pour quelques jours pendant la saison de coupage entre Octobre et Février
contacts : hambacherfor(est).blogsport.de facebook.com/hambacherforstbesetzung
Rentrer en contact : hambacherforst@riseup.net
Malgré la décision de justice,
le préfet de Haute-Garonne s’obstine
à détruire les espèces protégées à Val Tolosa
Les travaux pour le méga-centre commercial Val Tolosa ont redémarré, malgré la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui jugeait illégale la destruction des espèces protégées sur l’emprise du projet, le 13 juillet dernier.
Le redémarrage des travaux fait suite à une décision du préfet de région Occitanie, également préfet de Haute-Garonne, qui a délivré le 12 juillet un arrêté similaire à celui qui a été annulé le lendemain par la cour administrative d’appel, a indiqué France Nature Environnement jeudi 20 juillet. Pour Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, « cet arrêté est incontestablement illégal. L’Etat contourne ici
une décision de justice pour détruire inutilement des terres agricoles. Ce projet de méga centre commercial, qui ne présente pas d’intérêt public majeur, n’est pas soutenu par les élus et acteurs institutionnels : c’est un non-sens économique et écologique ! »
Le 13 juillet, la Cour administrative d’appel de Bordeaux jugeait illégale la destruction des espèces protégées sur une zone de 44 ha de terrains naturels sur lesquels le groupe UNIBAIL RODAMCO veut construire le méga centre commercial, rappelle l’association de défense de l’environnement. « France Nature Environnement Midi Pyrénées vient de déposer un référé pour demander la suspension de la nouvelle autorisation de destruction d’espèces protégées, et refuse de rencontrer le préfet de région Occitanie tant que celui-ci ne retire pas ce nouvel arrêté incompréhensible », poursuit-elle.
Complément d’information : L’arrêté préfectoral consultable ici .
Le 13 juillet, la Cour administrative d’appel de Bordeaux jugeait illégale la destruction des espèces protégées sur une zone de 44 ha de terrains naturels sur lesquels le groupe UNIBAIL RODAMCO veut construire le méga centre commercial, rappelle l’association de défense de l’environnement. « France Nature Environnement Midi Pyrénées vient de déposer un référé pour demander la suspension de la nouvelle autorisation de destruction d’espèces protégées, et refuse de rencontrer le préfet de région Occitanie tant que celui-ci ne retire pas ce nouvel arrêté incompréhensible », poursuit-elle.
Complément d’information : L’arrêté préfectoral consultable ici .
Source : France Nature Environnement (courriel) sur Reporterre
Infos du 24 au 31 juillet
Mardi
25 juillet
Près de Toulouse,
le préfet veut imposer un centre commercial
au mépris de la justice
Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), reportage
Quelques ouvriers, des camions et un enjeu central : la reprise des travaux de construction de Val Tolosa, un énième projet de centre commercial. Le 13 juillet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pourtant jugé illégale la destruction de l’habitat des espèces protégées présentes sur le site comme le trèfle écailleux, le renoncule à feuilles d’ophioglosse ou encore le sérapias en coeur. Mais la veille de cette décision de justice, le 12 juillet, et alors qu’un autre tribunal avait déjà rejeté le permis de construire, le préfet de Haute-Garonne a pris un arrêté pour autoriser la destruction de ces espèces, afin d’imposer ce centre commercial.
Lundi 24 juillet, il est cinq heures du matin quand une quarantaine de militants du collectif Non à Val Tolosa arrive pour bloquer les entrées de ce site de 44 hectares de terrains naturels situé sur la commune de Plaisance-du-Touch, à 15 kilomètres de Toulouse. Malgré la décision du tribunal de Bordeaux, la reprise des travaux semble actée.
C’est sur l’arrêté préfectoral méprisant la décision de la cour d’appel de Bordeaux que se base le conducteur des travaux pour laisser les ouvriers de Guintoli, filiale de NGE, un groupe français de BTP, investir le site. Il est neuf heures quand ils commencent à arriver. Face à eux le groupe de militants est clairsemé et les ouvriers rentrent sur le site, mais sans gros matériel. "À 9h30, un camion citerne est arrivé, puis vers 10 heures, un camion porte-char. Quand il a vu qu’on était devant, il n’a pas insisté et a continué sa route. Ils essaient de positionner des véhicules, tout en sachant qu’ils n’ont pas les autorisations nécessaires", explique Jean-Louis, membre du collectif.
Si les engins ne passent pas tous sur le site et arrivent au compte-goutte, la petite dizaine d’ouvriers présents sur place s’active. "Ils plantent des piquets censés délimiter les zones contenant des espèces protégées", note Tanguy, lui aussi membre du collectif et quelque peu bousculé dans la matinée par les agents de sécurité présents sur place, qui l’empêchaient d’avancer sur le site. L’atmosphère n’est à ce moment pourtant pas très tendue et les gendarmes présents sur place restent dans leur fourgonnette.
Les heures défilent dans une ambiance plutôt calme. "En début d’après-midi, quand les ouvriers ont constaté qu’on était en train d’alléger le dispositif, ils ont fait venir des engins comme une citerne de gasoil, un groupe électrogène pour éclairer la nuit. Le but évidemment c’est de très rapidement détruire la zone cette nuit en notre absence car si ils détruisent les espèces protégées, le référé ne marche plus. Ils pourront dire au juge qu’il n’y pas plus rien sur le plateau", rapporte Pascal Barbier, coprésident du collectif avant de poursuivre : "Comme il y avait un dispositif allégé, nous n’avons pas empêché les engins de s’installer mais nous les avons bloqué à l’intérieur. On leur a dit, on vous laissera sortir quand vous le ferez avec les gros engins." Il est un peu plus de 17 heures quand les ouvriers quittent le site.
La « vigilance extrême » de Nicolas Hulot
prise en défaut
Depuis dix ans, le dossier juridique de Val Tolosa n’en finit pas de s’épaissir. Alors que le maire de Plaisance-du-Touch avait accordé l’an dernier un nouveau permis de construire pour remplacer l’annulation du précédent permis par la justice, la bataille se joue désormais sur la question des espèces protégées. En 2013, la préfecture autorisait la destruction de ces espèces. La décision a été annulée une première fois en 2016 par le tribunal administratif de Toulouse. Unibail Rodamco, promoteur aux 72 centres commerciaux, premier groupe immobilier d’Europe et acteur du projet Val Tolosa, a fait appel et le dossier est parti vers le cour administrative d’appel de Bordeaux qui a donc annulé l’arrêté préfectoral le 13 juillet. Décision foulée aux pieds par le nouvel arrêté préfectoral du 12 juillet. Si les opposants au projet perçoivent la décision du préfet comme un passage en force, le coprésident du collectif reste serein et convaincu d’une issue positive à leurs actions : "La dérogation du préfet du 12 juillet concerne 46 espèces protégées. Or, le promoteur a recensé sur le terrain 47 espèces protégées. La sérapias en coeur a été oubliée par le préfet, donc sa décision n’est pas applicable." Le collectif a déposé un référé contre la décision préfectorale et promet de continuer à bloquer les travaux.
Vanessa Vertus - Reporterre
Le promoteur de Val Tolosa est peuplé d’amis d’Emmanuel Macron
La justice a condamné plusieurs fois le projet de centre commercial Val Tolosa, près de Toulouse. Mais ce projet porté par Unibail Rodamco est fortement soutenu par l’Etat. Plusieurs proches conseillers d’Emmanuel Macron sont ou ont été employés d’Unibail Rodamco.
Toulouse, correspondance
C’est l’énième épisode d’une bataille juridique pour empêcher un nouveau gaspillage de terres agricoles. Ce vendredi 28 juillet, le collectif Non à Val Tolosa attend la décision du tribunal administratif de Toulouse. Les opposants au centre commercial ont déposé un référé contre un arrêté préfectoral qui autorise la destruction d’espèces protégées. Parmi elles, le renoncule à feuille d’ophloglosse, le trèfle écailleux ou encore le serapias en coeur - au total 47 espèces.
L’arrêté préfectoral a été pris juste avant que la cour administrative d’appel de Bordeaux condamne un arrêté pris dans les mêmes termes. Mais le préfet veut imposer à la justice sa volonté de détruire. Et depuis près d’une semaine, le collectif bloque les entrées du site. Objectif : empêcher les pelleteuses de Guintoli, - la société en charge des travaux - de décaper les sols et détruire les espèces protégées qui y vivent. Mais si les engins de la société de BTP sont sur le devant de la scène, le commanditaire des travaux tient une place de choix.
Dans le dossier Val Tolosa, l’acteur phare du projet est le promoteur immobilier Unibail Rodamco. Sur son site, l’entreprise se présente comme le « premier groupe européen côté d’immobilier commercial spécialisé dans les Centres Commerciaux des grandes villes européennes ainsi que dans les bureaux et centre de Congrès-Expostions à Paris ».
Le groupe cultive surtout des relations très étroites avec le président de la République. Ainsi, Guillaume Poitrinal, président du groupe immobilier jusqu’en 2013, était un proche de François Hollande. Il a notamment été chargé par l’ancien locataire de l’Elysée de mettre en musique le choc de simplification, ensemble de mesures destiné à « simplifier la vie des Français et des entreprises » - et particulièrement dans le domaine immobilier. C’est par ailleurs un conseiller d’Unibail Rodamco, un ancien préfet, Jean-Pierre Duport, qui a inspiré l’article 28 du projet de loi Macron, en 2015, qui visait à simplifier le droit de l’urbanisme.
Des « marcheurs » proches de l’actuel Président de la République sont aussi bien positionnés dans l’organigramme du groupe. C’est le cas d’Astrid Panosyan, ancienne conseillère d’Emmanuel Macron lorsque ce dernier était à Bercy. Elle a un temps été pressentie pour devenir ministre du Travail et occupe la fonction de directrice générale chez Unibail Rodamco.
Autre pointure du groupe immobilier, mais qui est lui entré au gouvernement, Benjamin Griveaux. Actuel secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, il a été élu député de la cinquième circonscription de Paris aux dernières législatives sous l’étiquette La République en marche et a occupé les fonctions de porte-parole de la campagne d’Emmanuel Macron. Ce membre de la garde rapprochée du président de la République connait bien Unibail Rodamco…pour en avoir été le directeur de la communication du groupe de 2014 à 2016.
 |
|
Dans les rangs de l’Assemblée Nationale, une autre députée connait elle aussi très bien le dossier Val Tolosa : Monique Iborra, députée de la sixième circonscription de Haute Garonne. Cette ancienne membre du Parti socialiste, a rejoint la République en Marche après avoir été exclue du PS en 2016 et a fait de la création de ce centre commercial son cheval de bataille.
Europacity cultive l’ineptie et la censure
Le projet de mégacentre commercial et de loisirs d’Europacity, dans le Val-d’Oise, a ses thuriféraires qui y voient l’union heureuse du « commerce et de la culture ».
« Abrutissement fasciné », commentent les auteurs de cette tribune. En racontant la censure d’un film détournant la com’ du projet, ils décrivent le « réel » de cette relation : la soumission de la culture au commerce.
« Abrutissement fasciné », commentent les auteurs de cette tribune. En racontant la censure d’un film détournant la com’ du projet, ils décrivent le « réel » de cette relation : la soumission de la culture au commerce.
Quelques participant.es au collectif ZSD (Zad à Saint-Denis), lequel, en Seine-Saint-Denis, relaie les soutiens à la Zad de Notre-Dame-des-Landes et lutte contre les projets du Grand Paris.
Le 26 mai 2016, un ancien ministre de la Culture et de la Communication publie dans le quotidien de Patrick Drahi [1], une tribune à l’exergue mirobolant : « Il faut en finir avec l’antagonisme de principe entre le commerce et la culture ». Il y défend le projet Europacity, présenté comme un prolongement de l’ouverture culturelle porté il y a quarante ans par le Centre national d’art moderne (dit Centre Pompidou)
On passera sur le fait que, état d’urgence oblige, l’entrée dans le Centre, pour la bibliothèque ou le musée, s’est quelque peu rétrécie, le point de vérification des sacs à main et à dos faisant goulot d’étranglement, de même que la composition sociale de sa fréquentation : la cafétéria du cinquième étage, devenue un restaurant huppé, ne permet plus de s’y offrir un café avec un salaire de bibliothécaire : autant pour l’élargissement.
Ce texte, à sa façon, est un petit monument — un édicule : on ne sait si l’obscurité relative où se sent confiné Jean-Jacques Aillagon l’a poussé à l’écrire, ou s’il y avait intérêt, peut-être possède-t-il des parts chez Immochan, promoteur du projet. On n’ose imaginer le pire : que cette sottise soit une production sincère, que l’ancien ministre des Cultes se soit profondément convaincu qu’en effet il fallait « en finir avec l’antagonisme de principe entre le commerce et la culture ».
On passera sur le fait que, état d’urgence oblige, l’entrée dans le Centre, pour la bibliothèque ou le musée, s’est quelque peu rétrécie, le point de vérification des sacs à main et à dos faisant goulot d’étranglement, de même que la composition sociale de sa fréquentation : la cafétéria du cinquième étage, devenue un restaurant huppé, ne permet plus de s’y offrir un café avec un salaire de bibliothécaire : autant pour l’élargissement.
Ce texte, à sa façon, est un petit monument — un édicule : on ne sait si l’obscurité relative où se sent confiné Jean-Jacques Aillagon l’a poussé à l’écrire, ou s’il y avait intérêt, peut-être possède-t-il des parts chez Immochan, promoteur du projet. On n’ose imaginer le pire : que cette sottise soit une production sincère, que l’ancien ministre des Cultes se soit profondément convaincu qu’en effet il fallait « en finir avec l’antagonisme de principe entre le commerce et la culture ».
Les textes qui portaient la charge
de faire mentir l’image
Les bras en tombent.
À revoir le projet architectural présenté par l’agence BIG (brutal, inepte, grossier : BIG), on peut distinguer les séquences relevant de l’activité culturelle. Ici, un grand hall vide accueille les silhouettes stylisées de quelques animaux de la savane : on reconnaît la girafe et le lion, l’éléphant et son éléphanteau ; plus loin, l’intérieur d’un chapiteau accueille des jets d’eau éclairés par des spots électriques.
De visages humains se faisant entre eux transmission des récits, de corps incarnant des idées, de parole, point. De l’activité de parole transcrite dans un contenant qui permette qu’on l’éveille à volonté, de livres, il n’en est évidemment pas question. Ni théâtre, ni textes, ni conteurs, ni librairies : on fait du cultainment, chez BIG, mademoiselle — et Aillagon adore.
Il faut lire cette tribune, pour se convaincre qu’elle a effectivement été écrite, sans rire, par le monsieur qui redoutait d’être un peu out.
Qu’en est-il du réel, derrière l’abrutissement fasciné ?
Le réel, on le découvre par hasard, en préparant la rencontre organisée par l’Acipa à Notre-Dame-des-Landes. On cherche ce petit film malicieux de quelques potaches (qui prisent par-dessus tout la vie pleinement vécue, mais n’en excluent pas la fréquentation de bons auteurs), qui détournait la niaise présentation institutionnelle du projet Europacity. En lieu et place du lien Viméo, un mot succinct : « Déprogrammé pour atteinte au droit d’auteur », le 18 mai 2017. La date n’est pas innocente : c’était trois jours avant la journée de plantations organisée par le Collectif pour le triangle de Gonesse, qui a suscité largement adhésion et sympathie.
Voici où l’on en est, dans les fiévreux services de com’ d’Immochan : à faire déprogrammer, avant un rassemblement qui menaçait d’être suivi, cinq minutes de film, où des incrustations d’images venaient lézarder le diorama, mais où, ce qui importe, c’étaient les textes qui portaient la charge de faire mentir l’image.
Fragments écrits pour quelques-uns par les autrices qui les lisent, et extraits d’auteurs qui ont déjà gagné l’immortalité : non pas celle de l’Académie (Finkelkraut sera oublié le lendemain de sa mort). Mais la capacité à faire éclater la structure du monde pour qui les prend en pleine figure. Le Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, À nos amis, la Société du spectacle garderont une capacité à mouvoir les corps plus sûrement qu’aucune éructation d’enbicorné à palmes — ou d’aucun ex-ministre d’un gouvernement Raffarin.
La parole, irréductible ennemie de la communication
C’est si énorme et dérisoire, si absurdement crétin, qu’on ne peut qu’être ravis de l’avoir retrouvé mis en ligne sur le net. D’amicaux inconnus ont donc pris l’initiative de le télécharger, et de le partager de nouveau, peut-être sensibles à ce que, d’Ovide à Hendrix et d’Abélard à Duchamp, il semble un petit peu difficile de faire passer du détournement pour une atteinte au droit d’auteur.
Voir la vidéo : https://vimeo.com/224496339
On ne peut que souhaiter que cette initiative soit reprise, en invitant très chaleureusement les lecteurs et lectrices de Reporterre à télécharger ce petit film pour jouer aussi à le poster — juste pour voir. Pour voir si l’on peut occuper utilement les services juridiques d’Immochan, dix cadres malheureux qui twittent à répétition pendant leurs heures creuses. Pour voir si les situs et la pensée en actes ne trouvent pas plus de répondant que les films d’autopromotion du supermarché nouvelle allure auprès des internautes. Pour voir, parce qu’on est un peu curieux, et assez joueurs.
Et rappeler à monsieur Aillagon, bien respectueusement, que le seul « commerce » que puisse entretenir la sphère des arts avec la promotion actionnariale, c’est précisément ce verbe-là, « avoir », qui l’exprime. Et qu’une culture qui a commerce avec Wanda et Immochan est précisément en train de se faire baiser.
A Bure:
les déchets nucléaires,
« on aura passé une vie avec ça »
Depuis vingt ans, l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l’Andra, prépare les villageois de la Meuse à l’idée qu’ils vont vivre au-dessus des déchets nucléaires. Cette politique d’insertion dans le territoire se heurte à de nouvelles réticences, exacerbées par l’omniprésence des gendarmes. Des opposant.es se rassemblent du 11 au 13 août.
À Bure et Mandres-en-Barrois (Meuse), de notre envoyée spéciale.- « Vous notez quoi dans votre petit carnet ? » La voiture des gendarmes s’est approchée en silence. À l’intérieur, quatre hommes en tenue. Tout autour de nous, un rond-point vide bordé de bâtiments protégés par des grillages : un hôtel-restaurant, une écothèque, les archives d’EDF et, derrière un poste de garde où se relaient des vigiles privés, le laboratoire de recherche de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l’Andra. En une heure de balade, c’est le troisième contrôle d’identité.
 |
|
Le
laboratoire de l'Andra, entre Bure et Saudron, dans la Meuse, 12
juillet 2017 (JL)
|
Depuis un an, des opposant.e.s au centre d’enfouissement des rebuts radioactifs Cigéo occupent le bois Lejuc, la forêt que l’on devine non loin, derrière une butte, pour bloquer l’avancement du projet. Le mouvement draine de nouveaux militants, qui ravivent la lutte ancienne contre la « poubelle nucléaire » prévue pour 2025. « Andra dégage », « Brûle l’Andra » : peints à la bombe sur le bitume et les panneaux de circulation, les slogans entretiennent la tension et la troupe quadrille le terrain.
Seul lieu ouvert au public sur ce rond-point stratégique, l’hôtel du Bindeuil a fait l’objet d’une action d’intimidation par des militant.e.s trois semaines plus tôt : intrusion dans l’hôtel, bris de verre et de bouteilles, coups dans les fenêtres, départ de feu au petit matin. L’action a durci le ton des autorités contre les occupant.e.s du bois. La préfète s’est rendue sur les lieux quelques heures plus tard, des dizaines de gendarmes mobiles ont été affectés à la surveillance du territoire et des élus locaux, dont le sénateur Gérard Longuet, réclament l’ouverture d’une unité supplémentaire de gendarmerie.
L’établissement appartient à la commune de Bure, seul village de 84 habitants à posséder un hôtel-restaurant à 2,9 millions d’euros. Pas un café, ni une épicerie, ni une école n’a survécu à la désertification de ce coin de Meuse. Le département reçoit 30 millions d’euros par an en échange de la présence du futur site de stockage de déchets. Bure en bénéficie au premier chef. C’est ce symbole de l’argent du nucléaire et de l’achat du territoire que les militant.e.s disent vouloir dénoncer.
En cette veille de 14 Juillet, le Bindeuil est presque vide, à l’exception de la trentaine de gendarmes qui viennent y manger entre leurs tours de garde. Tant que les travaux de Cigéo ne démarrent pas, les clients manquent et la disproportion de l’infrastructure dans ce territoire dépeuplé saute aux yeux. Sa silhouette beige tranche sur le plat horizon de ce paysage de champs agricoles. À la tombée du jour, les lettres « EDF » s’éclairent en blanc cru sur la façade du cube design qui abrite les archives de l’électricien. De l’autre côté du rond-point, le logo vert, jaune et bleu de l’Andra s’illumine sur le puits d’accès au laboratoire, à 500 mètres sous terre. Des dizaines de lampadaires lâchent une lumière orange visible à des kilomètres à la ronde. Le plateau prend l’apparence d’une citadelle électrique, tout à sa démonstration d’autorité et de puissance économique.
 |
|
Sur le rond-point en face de l'hôtel construit avec
l'argent du GIP pour Cigéo, 12 juillet 2017 (JL)
|
Ces flots d’argent et cet afflux de force publique indiquent l’importance du projet en cours. Le centre industriel de stockage géologique (Cigéo) que l’Agence de gestion des déchets radioactifs s’apprête à construire doit accueillir les rebuts les plus dangereux du système nucléaire français : résidus du traitement des combustibles, produits de fission et d’activation, gaines, coques, boues… Ils contiennent différents radionucléides, à vie courte ou longue – jusqu’à 2 millions d’années pour le neptunium 237. Un processus législatif chaotique démarré en 1991 a choisi l’option de l’enfouissement en grande profondeur de ces matières ultratoxiques. Près de 265 kilomètres de tunnels et de galeries souterraines doivent être construits à 500 mètres sous terre, sur une surface totale d’une quinzaine de kilomètres carrés, pour y stocker près de 400 000 m3 de déchets. Pendant une centaine d’années, les exploitants du centre devront y enfouir les déchets venus des centres de La Hague, Marcoule et Cadarache, au rythme d’une centaine de convois de dix wagons par an – soit deux par semaine. Les « colis » doivent être entreposés dans des « alvéoles » horizontaux, d’une longueur comprise entre 100 et 525 mètres, en fonction de leur composition. Au bout de plus d’un siècle, le site devra être rebouché et gardé en l’état pour plusieurs milliers d’années.
Sur les schémas de l’Andra, l’activité de Cigéo est toujours représentée souterraine. En réalité, elle va bouleverser le paysage en surface : nouvelle gare, transport des déchets par trains et camions, zones de descenderie et d’accès aux puits, verses où stocker les millions de mètres cubes de gravats. « Oui, ce sera une zone industrielle. Il va y avoir un gros chantier », reconnaît sa responsable de la communication, Dominique Mer. Une concertation publique est annoncée sur l’impact paysager du projet. L’emprise des travaux sera considérable : deux zones de 270 hectares chacune, auxquelles s’ajoutent 70 hectares pour stocker les roches excavées. Soit l’équivalent de 25 Champs-de-Mars.
« Vous l’entendez tous les jours et ça entre dans votre tête »
Depuis 2001, l’Andra conduit une politique de parrainages de projets locaux : festival Renaissance des arts de la rue à Bar-le-Duc, Maison de la pierre, fête de la science… Sujets privilégiés : « la nature, le patrimoine, les relations intergénérationnelles ». Des thèmes qui concourent à rattacher ce projet de science-fiction au temps long de l’histoire humaine. « On est très sollicités, mais on étudie les dossiers au cas par cas », explique Mathieu Saint-Louis, chargé de communication de l’Agence. S’insérer dans le territoire mais avec discrétion. Le sponsoring du club de foot de Troyes a crispé certain.e.s à la vue du logo de l’Andra sur le maillot des joueurs. Entre 150 000 et 200 000 euros y sont consacrés chaque année, pour une aide moyenne de 1 000 euros par projet. « Des sommes pas énormes, pour soutenir de petits projets locaux ponctuels », précise l’agence. « Par rapport aux années 1970, ces grands projets sont plus difficiles, reconnaît Mathieu Saint-Louis. Aujourd’hui, on ne vient plus poser un projet comme ça. Il faut créer des liens avec le territoire. »
La présence sociale, économique et policière modifie bien des aspects du quotidien des habitants et installe Cigéo dans l’esprit des riverains, avant même que le moindre déchet n’y ait été enterré. « C’est comme manger cinq fruits et légumes par jour ou éteindre la lumière quand vous quittez une pièce : vous l’entendez tous les jours et ça entre dans votre tête, décrit un responsable de l’hôtel du Bindeuil. L’Andra, c’est comme l’homéopathie. Ça infuse lentement mais sûrement. » Depuis son cabinet de kinésithérapeute, Jean-François Bodenreider, fondateur de l’association Les habitants vigilants de Gondrecourt, explique : « On s’est rendu compte que les déchets nucléaires, on y pensait tous les jours. » Le géographe Pierre Ginet dénonce une « colonisation interne du territoire » par la métropolisation dans le livre qu’il écrit avec des opposant.e.s, L’Opposition citoyenne au projet Cigéo (L’Harmattan).
En réalité, l’essentiel de l’argent versé au nom de Cigéo ne transite pas par l’Andra. Ce sont les deux groupements d’intérêts publics (GIP) de la Meuse et de la Haute-Marne qui décident des mesures d’accompagnement économique du laboratoire de Bure (voir notre article à ce sujet). Les 15 communes distantes de moins de 10 km de Bure reçoivent une dotation au prorata de leur nombre d’habitant.e.s : 485 euros par personne et par an depuis 2007. Pour Sylvain Renard, maire de Biencourt-sur-Orge, commune toute proche, « le village de Bure ressemble à Las Vegas, avec un beau trottoir, du beau macadam, alors qu’il y a 20 ans, c’était un village agricole traversé par les paysans et leurs bêtes. C’est irrationnel ». Il dit refuser d’utiliser l’argent du GIP pour sa commune. Cette manne, « c’est scabreux ». À quelques kilomètres de là, dans sa ferme, un paysan s’emporte : « Ils achètent les gens. Ce n’est pas normal, tout cet argent qui arrive sans qu’on ait rien demandé. » Jean-Pierre Remmelé, ancien maire de Bonnet, village proche de Bure, se souvient de l’arrivée au milieu des années 1990 d’un représentant de l’Andra, « en costume trois pièces avec un attaché-case, venu tourner autour des dossiers communaux. Il passait à la mairie : “Il paraît que vous avez un projet d’investissement, monsieur le maire ? Envoyez-moi votre dossier, on va vous aider.” »
Depuis, l’Andra a diversifié ses vecteurs d’insertion territoriale. Elle organise des « ateliers de territoire » où des élus locaux viennent écouter comment Eiffage a construit le viaduc de Millau, où EDF parle du chantier de l’EPR et la SNCF de la ligne TGV Sud-Est Atlantique. Partage de savoirs et récits d’expériences entre aménageurs. Elle finance aussi un site réalisé par la revue Uzbek et Rica, Les Arpenteurs, où l’on dit vouloir écrire sur « les générations futures ». On y lit d’élogieux comptes-rendus des réflexions de l’Andra sur la mémoire et de son site d’open data.
En juin, l’agence a conduit une opération de porte-à-porte dans 45 communes pour étudier l’image de Cigéo et communiquer sur le projet. Un tiers des personnes rencontrées sont favorables au projet, 18 % défavorables et les autres n’expriment pas d’opinion particulière, selon l’agence. Plus les habitants sont proches du futur centre, plus ils le connaissent et plus ils y sont favorables. Mais impossible de vérifier ni d’en savoir plus : malgré un rendez-vous à l’Andra fixé à la date de leur choix afin de leur laisser le temps de synthétiser leurs données, ses porte-parole ne présentent pas les enseignements qu’ils en tirent.
Dans la brochure distribuée aux habitant.e.s, il n’y a rien sur les futurs rejets radioactifs du centre, rien sur les risques liés à son exploitation, rien non plus sur l’impact délétère sur l’image du sud de la Meuse ou les effets sur la valeur immobilière. « Ces déchets sont dangereux. Le risque, c’est le principe fondamental du projet, répond Mathieu Saint-Louis. Mais ces questions sont complexes. Cette brochure, ce n’était pas vraiment la place pour en parler. » Pour Dominique Mer, « on ne [le] cache pas. Mais ce n’est pas l’argument numéro un qu’on met en avant ». Par contre, le quatre-pages trouve la place pour décrire « un grand projet national scientifique et industriel de pointe », « une contribution au développement du territoire », « la garantie d’une activité industrielle pour un siècle » et « des centaines d’emplois créés ». Craignent-ils la création d’une ZAD ? « Ce sont les mêmes luttes avec les mêmes personnes, croit savoir l’Andra. Ils sont contre Cigéo mais pourraient être contre un autre projet. Ils sont contre la société. C’est très idéologique. » Des opposant.e.s organisent un festival du 11 au 13 août, les Bure’lesques.
« Pour certains, l’Andra, c’est plus que Dieu »
L’insertion dans le territoire rencontre des limites : l’attachement des riverain.e.s à leurs terres et leur gêne face au déploiement croissant de moyens financiers et de gendarmes. En mai dernier, le conseil municipal de Mandres-en-Barrois, 130 habitants, vote à une courte majorité l’échange de sa forêt communale, le bois Lejuc, contre celle qu’a achetée l’Andra. C’est dans le bois Lejuc que l’agence prévoit de construire les puits d’accès au centre d’enfouissement. Un premier vote municipal, un an auparavant, a été annulé par la justice. Cette fois-ci, 33 habitant.e.s du village, un quart de sa population, attaquent la cession devant le tribunal administratif. Dans un texte collectif, ils dénoncent les conflits d’intérêts qui entachent le vote : membres des familles d’élus employés par l’Andra, terres et baux de chasse obtenus grâce à l’agence. Le référé suspension a été rejeté, mais un recours sur le fond est en cours devant le tribunal administratif de Nancy.« Ce n’est pas à nous, 11 conseillers municipaux, de voter pour un projet à 50 milliards d’euros et de prendre une décision pareille ! explique un élu qui a voté contre mais préfère garder l’anonymat. C’est aberrant. » Indispensable à l’avancement des travaux de Cigéo, le bois Lejuc est devenu un épicentre de la lutte contre l’enfouissement des déchets nucléaires. Il est occupé depuis plus d’un an par une centaine de personnes qui y construisent barricades et cabanes (voir ici notre reportage). « Le bois, on allait y faire les asperges, les escargots, des récoltes de champignons et de framboises, se souvient une requérante, aujourd’hui retraitée. C’était formidable. On veut le garder. J’ai vu des jeunes qui ne savent plus ce qu’est une ancolie qui pousse dans un bois. Moi j’y tiens. C’est le charme de notre région. » Elle poursuit : « Pour moi, Meusienne, ce qui m’a viscéralement scandalisée, c’est qu’on nous traite comme une bande d’Indiens dans un pays sous-développé. La Meuse, ce sont des terres fertiles. C’est une splendeur. »
Malgré les promesses des élus locaux, le département continue à se dépeupler. Le collège de Montiers-sur-Saulx, commune proche, pourrait fermer. « On nous a présenté ce projet comme un moyen de développement, résume une requérante, et on voit tous les jours que c’est un projet de désertification. Il y a eu une période où les jeunes ménages faisaient vivre l’école. Mais aujourd’hui, les jeunes gens ne s’installent plus. » Une autre explique : « J’ai toujours été opposée à ce projet, mais on se résigne. Ça fait 25 ans qu’ils sont là. Je ne savais pas qu’on pouvait les attaquer en justice. » Pour Corinne François, militante de l’association Bure Stop, « cette plainte, c’est extrêmement important. C’est la première fois que des habitants sortent du bois et s’opposent frontalement ».
L’Andra prévoyait de déposer son dossier de demande d’autorisation de construction fin 2018 mais vient de le reporter de six mois à mi-2019. Selon son directeur général, Pierre-Marie Abadie, « faire du projet un levier pour sortir du nucléaire est une erreur ». Il rappelle que les déchets radioactifs sont là et qu'« il est de notre responsabilité générationnelle de les gérer ». La construction de Cigéo « n'épuise en rien le débat sur l'opportunité de poursuivre ou non le nucléaire ». La phase pilote de Cigéo doit démarrer en 2025. Mais plus le projet se précise, plus les inquiétudes prennent forme dans le village de Mandre-en-Barrois. C’est l’une des quatre communes, avec Bure, Bonnet et Ribeaucourt, à se trouver sur la Zira, la zone en dessous de laquelle seront enfouis les déchets. « Maintenant, dans le village, c’est la guerre, décrit une requérante. Il y avait des conflits ancestraux mais les frontières ont bougé. Maintenant il y a les pour et les contre l’Andra. C’est le seul sujet. D’un côté ou de l’autre, on ne peut plus discuter. Il y en a qui ne se disent plus bonjour. C’est à cause de l’argent. Pour certains, l’Andra, c’est plus que Dieu. »
Pour Marie-Ève Bodenreider, kinésithérapeute à Gondrecourt, « c’est une pression énorme au quotidien depuis 20 ans. La pression est tellement présente que dans la tête de beaucoup de gens, le projet est déjà fait. Il y en a même qui croient que les déchets sont déjà là. L’Andra a réussi à s’immiscer dans la tête des gens ». Elle décrit une présence ténue mais permanente de l’Agence dans le quotidien villageois : DVD disponibles en mairie, sigle de l’Agence sur le château d’eau à l’entrée du village, affiches annonçant des expositions de l’Andra dans les écoles, participation financière aux voyages scolaires. Après avoir écrit sur sa voiture « Mandres Levet vous contre l’Andra » (un jeu de mots autour du nom du maire de Mandres, Xavier Levet), elle est convoquée au commissariat, photographiée et ses empreintes digitales relevées. Une autre fois, elle se trouve à la pharmacie. Deux gendarmes entrent et vont la voir : « “Il y a une réunion ce soir ?” – “Oui.” – “Vous y allez ?” – “Non.” Ils attendent. Et je ressors encadrée par deux gendarmes. » Elle conclut : « On aura passé une vie avec ça. » Une requérante couche sur le papier sa position et me transmet son message manuscrit sur deux feuilles de bloc-notes : « C’est faire preuve d’égoïsme que d’accepter une transaction quelconque avec les représentants de l’Andra. Que ce soit sur le plan communautaire ou privé. L’intérêt immédiat occulte les conséquences à long terme, par simple inconscience ou aveuglement volontaire. Dans tous les cas, c’est criminel de vouloir imposer un tel risque à toute une population. » Un agriculteur confie à la fin d’un entretien : « L’Andra, ça nous tracasse. À une réunion, on a entendu quelqu’un dire que le village va disparaître. On ne sait rien. Rien. »
L’omniprésence des gendarmes sur les routes départementales exerce une pression supplémentaire, qui tourne à l’absurde dans les récits des habitant.e.s. Quand de jeunes militant.e.s cherchent à s’installer à Biencourt, le maire, Sylvain Renard, souhaite les rencontrer. Alors qu’il roule vers Bure pour les voir, il se fait contrôler par les gendarmes.
« Vous allez où ?
– À la maison de la résistance [nom du logement collectif des militant.e.s anti-Cigéo – ndlr].
– Vos papiers et descendez du véhicule. »
Pour Marie-Ève Bodenreider, kinésithérapeute à Gondrecourt, « c’est une pression énorme au quotidien depuis 20 ans. La pression est tellement présente que dans la tête de beaucoup de gens, le projet est déjà fait. Il y en a même qui croient que les déchets sont déjà là. L’Andra a réussi à s’immiscer dans la tête des gens ». Elle décrit une présence ténue mais permanente de l’Agence dans le quotidien villageois : DVD disponibles en mairie, sigle de l’Agence sur le château d’eau à l’entrée du village, affiches annonçant des expositions de l’Andra dans les écoles, participation financière aux voyages scolaires. Après avoir écrit sur sa voiture « Mandres Levet vous contre l’Andra » (un jeu de mots autour du nom du maire de Mandres, Xavier Levet), elle est convoquée au commissariat, photographiée et ses empreintes digitales relevées. Une autre fois, elle se trouve à la pharmacie. Deux gendarmes entrent et vont la voir : « “Il y a une réunion ce soir ?” – “Oui.” – “Vous y allez ?” – “Non.” Ils attendent. Et je ressors encadrée par deux gendarmes. » Elle conclut : « On aura passé une vie avec ça. » Une requérante couche sur le papier sa position et me transmet son message manuscrit sur deux feuilles de bloc-notes : « C’est faire preuve d’égoïsme que d’accepter une transaction quelconque avec les représentants de l’Andra. Que ce soit sur le plan communautaire ou privé. L’intérêt immédiat occulte les conséquences à long terme, par simple inconscience ou aveuglement volontaire. Dans tous les cas, c’est criminel de vouloir imposer un tel risque à toute une population. » Un agriculteur confie à la fin d’un entretien : « L’Andra, ça nous tracasse. À une réunion, on a entendu quelqu’un dire que le village va disparaître. On ne sait rien. Rien. »
L’omniprésence des gendarmes sur les routes départementales exerce une pression supplémentaire, qui tourne à l’absurde dans les récits des habitant.e.s. Quand de jeunes militant.e.s cherchent à s’installer à Biencourt, le maire, Sylvain Renard, souhaite les rencontrer. Alors qu’il roule vers Bure pour les voir, il se fait contrôler par les gendarmes.
« Vous allez où ?
– À la maison de la résistance [nom du logement collectif des militant.e.s anti-Cigéo – ndlr].
– Vos papiers et descendez du véhicule. »
Une fois identifié par le commandant Dubois, il peut poursuivre sa route. Mais l’épisode a choqué l’édile. Un habitant de Mandres-en-Barrois raconte s’être fait contrôler 42 fois entre juillet et août 2016, au moment où des opposant.e.s occupaient le bois Lejuc. « Ils ont l’ordre de ne pas arrêter les gens du coin, mais comme ils changent tout le temps, ils ne nous connaissent pas. Et comme ma voiture n’est pas terrible, ça fait école », décrit un autre habitant. « Dès que tu fais une réunion dans la zone, tu as une estafette de gendarmes garée devant l’entrée de la salle », témoigne Corinne François, de Bure Stop. Un militant installé à Mandres décrit des rondes incessantes de gendarmes devant son logement collectif, y compris de nuit : « J’ai compris l’expression “entendre le bruit des bottes”. Ils regardent souvent à travers ma fenêtre et chaque fois qu’ils me voient, ils me filment. » Un paysan se souvient de contrôles « deux, trois par jour sur le même chemin » à l’automne dernier.
Les agriculteurs sont à la fois les premiers touchés par le projet de l’Andra et ceux auxquels elle accorde le plus d’attention. L’Agence a acquis 3 000 hectares de terres, dont une grande partie doit servir aux mesures de compensation et aux échanges de terres avec les paysans. Ces achats massifs ont contribué à faire augmenter le prix du foncier, estiment plusieurs paysans : « On ne peut plus s’agrandir », se désole un agriculteur. « On ne peut plus s’installer, s’inquiète Louis, un paysan de 20 ans, car il faut s’aligner sur les prix de l’Andra et les banques ne suivent plus. Je ne sais pas si je vais rester ici. » Mais d’autres tempèrent : le prix des parcelles augmente partout en France et en Meuse (5 000 euros l’hectare), il reste inférieur à la moyenne nationale (5 700 euros).
Comme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une partie des terres de l’Andra est prêtée en baux précaires à des paysans qui continuent de les cultiver. Mais en Meuse et en Haute-Marne, l’Andra a adopté une stratégie de discrétion et d’alliance avec les acteurs de territoire. Une convention a été signée en 2012 avec la Safer, l’organisme agricole chargé de l’aménagement foncier, qui effectue elle-même les démarches auprès des agriculteurs. « Ça permet à l’Andra de s’implanter, mais ça empêche que tout soit à eux, décrypte un cultivateur qui a participé à ces discussions. L’Andra aurait exproprié de toute façon. Si un jour le projet ne se fait pas… », les parcelles resteront dans le giron de la profession. « Cette méthode douce, c’est très malin. Ça a été très bien joué de la part de l’Andra. Ils ont impliqué tout le monde. Le monde agricole n’a pas pu s’opposer. » Un agriculteur s’interroge : « Dans 20 ans, on ne sait pas comment sera Bure. Mais ça va être difficile de se lancer en maraîchage bio et en vente directe. Je vis très mal cette situation. On m’impose ce projet sans m’avoir jamais demandé. Je ne ferai pas ce métier, je m’en irai. Mais je reste attaché à cette terre. Je me vois mal être agriculteur ailleurs. C’est affectif. »
Sous couvert de l’anonymat, plusieurs paysans racontent des échanges vécus comme des pressions avec la personne que l’Andra a chargée des négociations pour obtenir le foncier, Emmanuel Hance. Son nom est vilipendé dans les tags et sur les barricades des occupant.e.s du bois Lejuc. Certains le surnomment « le shérif de l’Andra ». Les porte-parole de l’Agence contestent cette vision : « Il cristallise cette image et ces tractations, mais il a beaucoup été sur le terrain. La majorité des agriculteurs sont plutôt satisfaits. On aurait pu exproprier tout le monde. Mais pourquoi se fâcher avec la profession agricole si on peut faire autrement ? » Mi-juillet 2017, l’Agence annonce avoir acquis 98 % des parcelles dont elle a besoin.
D’un côté, la démonstration de force technique et économique de l’Andra, l’un des laboratoires les mieux financés de la recherche française (plus de 1,5 milliard d’euros en 20 ans). De l’autre, les voix discrètes des quelques centaines de voisin.e.s de la future poubelle nucléaire. Jusqu’ici, le spectacle du vertigineux trou conçu pour confiner les rebuts radioactifs pendant des milliers d’années a accaparé toute l’attention nationale.
Jade Lindgaard – Médiapart
Creys-Malville (Isère), reportage
C’est une petite stèle en granit rose, plantée au milieu des champs de maïs, non loin d’un grand chêne. Presque incongrue sur cette douce colline dite « du Devin », qui surplombe la vallée du Rhône. Gravée en lettres d’or, une épitaphe : « En souvenir de Vital Michalon, 31 ans, tué par les forces de l’État le 31 juillet 1977 lors de la manifestation contre Superphénix. »
« Il est tombé à une quarantaine de mètres de là, plus haut sur la pente, indique Yves François, agriculteur de la commune de Creys-Mépieu. L’État ne l’a jamais reconnu, mais nous sommes convaincus qu’il a été tué par le souffle d’une grenade offensive. » Outre la mort brutale du jeune professeur de physique, deux manifestants (et un policier) ont été mutilés — Manfred Schultz et Michel Grandjean — et des centaines d’autres blessés ce jour-là, dans une foule de plus de 60.000 personnes. Un drame terrible qui a cassé durablement le mouvement antinucléaire français. Comment en est-on arrivé là ? Quarante ans après les faits, Reporterre reprend le film des événements. Car « il faut raconter, inlassablement, pour que la mémoire se transmette et que ces drames s’arrêtent », insiste Paul Michalon, l’un des frères de Vital, présent à ses côtés ce 31 juillet [*].
En 1974, le Premier ministre Pierre Messmer lance l’accélération du programme nucléaire, avec pour objectif « l’indépendance énergétique de la France ». Un des piliers de ce programme est constitué des surgénérateurs. Ces réacteurs nucléaires dits « à neutrons rapides à caloporteur sodium » permettent (théoriquement) de générer de l’énergie à partir de combustible composé d’uranium et de plutonium issu du retraitement des combustibles déjà utilisés par des centrales classiques. Cerise sur le gâteau des nucléaristes, les surgénérateurs peuvent produire du plutonium fissile, réutilisable notamment dans les bombes atomiques. La vitrine de ce savoir-faire à la française s’appelle Superphénix : la centrale est annoncée en grande pompe, et les travaux préparatoires (forage, fouilles) commencent sur les berges du Rhône, à la limite entre l’Ain et l’Isère, à Malville.
« Tout le monde pariait sur cette invention, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) programmait plus d’une vingtaine de surgénérateurs en 2000, explique Raymond Avrillier, qui a suivi le dossier Creys-Malville pour la Fédération de protection de la nature de Rhône-Alpes (Frapna). Derrière, il y avait un intérêt militaire évident : fabriquer en grande quantité et à moindre coût des armes atomiques à partir du plutonium de ces réacteurs. » Le nucléaire constitue le cœur des gouvernements Pompidou puis Giscard : la « raison d’État », intouchable, inattaquable. « Dès cette époque, toute contestation a été considérée comme une atteinte à la sûreté de l’État, et a été gérée comme un problème militaire, ajoute-t-il. Mais nous avions sous-estimé cette dimension. »
Car bientôt, malgré l’engouement des autorités pour l’atome, des voix discordantes se font entendre. Scientifiques et citoyens font valoir leurs doutes et leurs craintes, à l’instar de Vital Michalon. « Vital a fait des études de physique, et il a vite compris que le surgénérateur était une folie, inutile et dangereux, se rappelle Paul Michalon. Nous étions tous deux baignés dans les courants antimilitariste et antitechnologie de cette époque post-soixante-huitarde. » Pour autant, les deux frères ne sont membres d’aucun parti et n’adhèrent pas aux comités Malville qui se forment un peu partout à partir de 1975.
« L’opposition à la centrale de Superphénix a été initiée par des groupes antinucléaires issus des grandes villes de la région, Grenoble, Lyon, Valence, raconte Georges David, ancien opposant. En s’inspirant d’autres luttes, comme celle du Larzac, nous avons cherché à construire un mouvement capable de mobiliser en masse sans recourir à la violence, avec le soutien des populations locales. » Réunions d’information, recours juridiques, création de médias (le journal Super Pholix, Radio Active), rassemblements. La mobilisation monte, malgré les premières répressions lors de l’occupation du site en juillet 1976. Le mouvement antinucléaire français naissant se structure. Forte de cette dynamique, la coordination des comités Malville décide d’organiser une grande marche pacifiste le 31 juillet 1977.
Très vite, l’événement s’annonce exceptionnel, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues, de France, de la Suisse voisine et d’Allemagne, où un surgénérateur est également en projet. Très vite aussi, on comprend que l’Etat se prépare… à réprimer. La manifestation n’est pas autorisée, toute circulation est interdite dans une zone de cinq km autour du chantier. « Le secteur a été mis en état de siège quinze jours avant le 31 juillet, se rappelle Yves François. On était sans cesse contrôlés, il y avait des militaires partout. »
Il est environ midi quand les premiers milliers de manifestants parviennent dans les champs pentus de la colline du Devin. Parmi eux, Vital et Paul. En contrebas, des rangées de policiers casqués, armés, bloquent le passage derrière leurs boucliers. En haut, l’hélicoptère de la préfecture sillonne un ciel pluvieux. « C’était le bout de l’entonnoir, comme un piège, un guet-apens : impossible d’avancer, difficile de reculer puisque des milliers d’autres arrivaient sans cesse, se souvient Raymond Avrillier. Pacifistes, nous n’étions pas suffisamment préparés à répondre à une agression, nous n’étions pas bien organisés pour faire face à un tel déferlement de violence. »
La suite des événements tragiques nous est racontée par Paul Michalon :
« On s’est trouvés en haut d’un pré, et ça commençait à chauffer. Il y avait visiblement quelques dizaines d’excités qui voulaient en découdre, qui balançaient des pierres. L’immense majorité d’entre nous assistions à cela, ahuris, stupéfaits. Que va-t-il se passer ? Le ton a monté, des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes, dites “offensives”, sont parties. Une horreur. Quand elle tombe près de vous, elle provoque un effet de souffle terrible, qui vous déplace. Nous avons vu Manfred Schultz perdre sa main en tentant de renvoyer une de ces grenades, puis Michel Grandjean, transporté sur un brancard et tenant ce qu’il lui restait de jambe, le visage ravagé de douleur. C’était épouvantable, la guerre, au milieu de la pluie, du brouillard, de la fumée, des détonations. Il fallait qu’on s’en aille. Mais les policiers se sont préparés à charger, leurs fusils lanceurs de grenades sont passés en position horizontale : ils nous tiraient dessus ! Tout est parti en désordre, c’était la débandade, la panique. Chacun pour soi, il s’agissait de sauver sa peau.
Les agriculteurs sont à la fois les premiers touchés par le projet de l’Andra et ceux auxquels elle accorde le plus d’attention. L’Agence a acquis 3 000 hectares de terres, dont une grande partie doit servir aux mesures de compensation et aux échanges de terres avec les paysans. Ces achats massifs ont contribué à faire augmenter le prix du foncier, estiment plusieurs paysans : « On ne peut plus s’agrandir », se désole un agriculteur. « On ne peut plus s’installer, s’inquiète Louis, un paysan de 20 ans, car il faut s’aligner sur les prix de l’Andra et les banques ne suivent plus. Je ne sais pas si je vais rester ici. » Mais d’autres tempèrent : le prix des parcelles augmente partout en France et en Meuse (5 000 euros l’hectare), il reste inférieur à la moyenne nationale (5 700 euros).
Comme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une partie des terres de l’Andra est prêtée en baux précaires à des paysans qui continuent de les cultiver. Mais en Meuse et en Haute-Marne, l’Andra a adopté une stratégie de discrétion et d’alliance avec les acteurs de territoire. Une convention a été signée en 2012 avec la Safer, l’organisme agricole chargé de l’aménagement foncier, qui effectue elle-même les démarches auprès des agriculteurs. « Ça permet à l’Andra de s’implanter, mais ça empêche que tout soit à eux, décrypte un cultivateur qui a participé à ces discussions. L’Andra aurait exproprié de toute façon. Si un jour le projet ne se fait pas… », les parcelles resteront dans le giron de la profession. « Cette méthode douce, c’est très malin. Ça a été très bien joué de la part de l’Andra. Ils ont impliqué tout le monde. Le monde agricole n’a pas pu s’opposer. » Un agriculteur s’interroge : « Dans 20 ans, on ne sait pas comment sera Bure. Mais ça va être difficile de se lancer en maraîchage bio et en vente directe. Je vis très mal cette situation. On m’impose ce projet sans m’avoir jamais demandé. Je ne ferai pas ce métier, je m’en irai. Mais je reste attaché à cette terre. Je me vois mal être agriculteur ailleurs. C’est affectif. »
Sous couvert de l’anonymat, plusieurs paysans racontent des échanges vécus comme des pressions avec la personne que l’Andra a chargée des négociations pour obtenir le foncier, Emmanuel Hance. Son nom est vilipendé dans les tags et sur les barricades des occupant.e.s du bois Lejuc. Certains le surnomment « le shérif de l’Andra ». Les porte-parole de l’Agence contestent cette vision : « Il cristallise cette image et ces tractations, mais il a beaucoup été sur le terrain. La majorité des agriculteurs sont plutôt satisfaits. On aurait pu exproprier tout le monde. Mais pourquoi se fâcher avec la profession agricole si on peut faire autrement ? » Mi-juillet 2017, l’Agence annonce avoir acquis 98 % des parcelles dont elle a besoin.
D’un côté, la démonstration de force technique et économique de l’Andra, l’un des laboratoires les mieux financés de la recherche française (plus de 1,5 milliard d’euros en 20 ans). De l’autre, les voix discrètes des quelques centaines de voisin.e.s de la future poubelle nucléaire. Jusqu’ici, le spectacle du vertigineux trou conçu pour confiner les rebuts radioactifs pendant des milliers d’années a accaparé toute l’attention nationale.
Jade Lindgaard – Médiapart
Boîte noire : Pour ce reportage, je me suis rendue deux fois sur place : une première fois début juin à la rencontre d’habitant.e.s de Mandres-en-Barrois et de Bure, puis les 12 et 13 juillet, à Bure et Saudron pour un rendez-vous avec les porte-parole de l’Andra. Au total, j’ai interviewé une vingtaine d’habitants ou discuté avec eux. La plupart d’entre eux ont demandé à ne pas voir leur nom cité dans l’article. Je n’ai donc publié que les patronymes des personnes ouvertement militantes et animant des collectifs.
Il y a quarante ans,
l’Etat tuait Vital Michalon,
jeune antinucléaire
Le
31 juillet 1977, près de 60.000 antinucléaires
convergeaient vers le site de la centrale en chantier de Superphénix,
à Malville, en Isère. La violente répression causait une centaine
de blessés et la mort de Vital Michalon. La férocité de l’État
ce jour-là a profondément marqué le mouvement antinucléaire.
Reporterre raconte cette journée tragique, avec ceux qui l’ont
vécue, dont un frère de Vital.
Creys-Malville (Isère), reportage
C’est une petite stèle en granit rose, plantée au milieu des champs de maïs, non loin d’un grand chêne. Presque incongrue sur cette douce colline dite « du Devin », qui surplombe la vallée du Rhône. Gravée en lettres d’or, une épitaphe : « En souvenir de Vital Michalon, 31 ans, tué par les forces de l’État le 31 juillet 1977 lors de la manifestation contre Superphénix. »
« Il est tombé à une quarantaine de mètres de là, plus haut sur la pente, indique Yves François, agriculteur de la commune de Creys-Mépieu. L’État ne l’a jamais reconnu, mais nous sommes convaincus qu’il a été tué par le souffle d’une grenade offensive. » Outre la mort brutale du jeune professeur de physique, deux manifestants (et un policier) ont été mutilés — Manfred Schultz et Michel Grandjean — et des centaines d’autres blessés ce jour-là, dans une foule de plus de 60.000 personnes. Un drame terrible qui a cassé durablement le mouvement antinucléaire français. Comment en est-on arrivé là ? Quarante ans après les faits, Reporterre reprend le film des événements. Car « il faut raconter, inlassablement, pour que la mémoire se transmette et que ces drames s’arrêtent », insiste Paul Michalon, l’un des frères de Vital, présent à ses côtés ce 31 juillet [*].
En 1974, le Premier ministre Pierre Messmer lance l’accélération du programme nucléaire, avec pour objectif « l’indépendance énergétique de la France ». Un des piliers de ce programme est constitué des surgénérateurs. Ces réacteurs nucléaires dits « à neutrons rapides à caloporteur sodium » permettent (théoriquement) de générer de l’énergie à partir de combustible composé d’uranium et de plutonium issu du retraitement des combustibles déjà utilisés par des centrales classiques. Cerise sur le gâteau des nucléaristes, les surgénérateurs peuvent produire du plutonium fissile, réutilisable notamment dans les bombes atomiques. La vitrine de ce savoir-faire à la française s’appelle Superphénix : la centrale est annoncée en grande pompe, et les travaux préparatoires (forage, fouilles) commencent sur les berges du Rhône, à la limite entre l’Ain et l’Isère, à Malville.
La « raison d’État », intouchable, inattaquable
« Tout le monde pariait sur cette invention, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) programmait plus d’une vingtaine de surgénérateurs en 2000, explique Raymond Avrillier, qui a suivi le dossier Creys-Malville pour la Fédération de protection de la nature de Rhône-Alpes (Frapna). Derrière, il y avait un intérêt militaire évident : fabriquer en grande quantité et à moindre coût des armes atomiques à partir du plutonium de ces réacteurs. » Le nucléaire constitue le cœur des gouvernements Pompidou puis Giscard : la « raison d’État », intouchable, inattaquable. « Dès cette époque, toute contestation a été considérée comme une atteinte à la sûreté de l’État, et a été gérée comme un problème militaire, ajoute-t-il. Mais nous avions sous-estimé cette dimension. »
Car bientôt, malgré l’engouement des autorités pour l’atome, des voix discordantes se font entendre. Scientifiques et citoyens font valoir leurs doutes et leurs craintes, à l’instar de Vital Michalon. « Vital a fait des études de physique, et il a vite compris que le surgénérateur était une folie, inutile et dangereux, se rappelle Paul Michalon. Nous étions tous deux baignés dans les courants antimilitariste et antitechnologie de cette époque post-soixante-huitarde. » Pour autant, les deux frères ne sont membres d’aucun parti et n’adhèrent pas aux comités Malville qui se forment un peu partout à partir de 1975.
« L’opposition à la centrale de Superphénix a été initiée par des groupes antinucléaires issus des grandes villes de la région, Grenoble, Lyon, Valence, raconte Georges David, ancien opposant. En s’inspirant d’autres luttes, comme celle du Larzac, nous avons cherché à construire un mouvement capable de mobiliser en masse sans recourir à la violence, avec le soutien des populations locales. » Réunions d’information, recours juridiques, création de médias (le journal Super Pholix, Radio Active), rassemblements. La mobilisation monte, malgré les premières répressions lors de l’occupation du site en juillet 1976. Le mouvement antinucléaire français naissant se structure. Forte de cette dynamique, la coordination des comités Malville décide d’organiser une grande marche pacifiste le 31 juillet 1977.
Très vite, l’événement s’annonce exceptionnel, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues, de France, de la Suisse voisine et d’Allemagne, où un surgénérateur est également en projet. Très vite aussi, on comprend que l’Etat se prépare… à réprimer. La manifestation n’est pas autorisée, toute circulation est interdite dans une zone de cinq km autour du chantier. « Le secteur a été mis en état de siège quinze jours avant le 31 juillet, se rappelle Yves François. On était sans cesse contrôlés, il y avait des militaires partout. »
« C’était le bout de l’entonnoir, comme un piège, un guet-apens »
Depuis Aix-en-Provence, Vital Michalon se rend en Isère avec sept amis, dont son frère Paul. « Dans la voiture, une Peugeot 403 familiale, nous étions enthousiastes et remontés, se remémore-t-il. Vital parlait avec emphase des idées du philosophe chrétien Pierre Teilhard de Chardin… Vital n’était pas du tout un anarchiste enragé comme on a pu le dire ensuite. »
Après une nuit pluvieuse, les milliers de manifestants se mettent en marche, sur des routes étroites et boueuses. « Vu la petitesse des routes et les restrictions de circulation, nous avions décidé de diviser la marche en trois cortèges, qui devaient tous converger à Faverges, sur la colline du Devin, raconte Georges David. Nous avions prévu des liaisons par talkies-walkies entre les groupes, mais les intempéries ont bloqué la communication. » Plusieurs habitants sont également empêchés de se rendre au rassemblement, tel Maurice François, le père d’Yves : « Les policiers sont venus faire une perquisition à la ferme le matin, ils n’ont rien trouvé, mais m’ont emmené au poste signer la déposition, se rappelle l’octogénaire. Ils m’ont fait attendre jusqu’à 12 h, je n’ai pas pu rejoindre le cortège. » Des détails qui n’en sont pas : « Les autorités ont tout fait pour mettre les populations locales dans l’impossibilité de réagir, estime Georges David. Sans la présence fondamentale des habitants, l’État a pu castagner tranquillement les militants. »
Il est environ midi quand les premiers milliers de manifestants parviennent dans les champs pentus de la colline du Devin. Parmi eux, Vital et Paul. En contrebas, des rangées de policiers casqués, armés, bloquent le passage derrière leurs boucliers. En haut, l’hélicoptère de la préfecture sillonne un ciel pluvieux. « C’était le bout de l’entonnoir, comme un piège, un guet-apens : impossible d’avancer, difficile de reculer puisque des milliers d’autres arrivaient sans cesse, se souvient Raymond Avrillier. Pacifistes, nous n’étions pas suffisamment préparés à répondre à une agression, nous n’étions pas bien organisés pour faire face à un tel déferlement de violence. »
La suite des événements tragiques nous est racontée par Paul Michalon :
« On s’est trouvés en haut d’un pré, et ça commençait à chauffer. Il y avait visiblement quelques dizaines d’excités qui voulaient en découdre, qui balançaient des pierres. L’immense majorité d’entre nous assistions à cela, ahuris, stupéfaits. Que va-t-il se passer ? Le ton a monté, des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes, dites “offensives”, sont parties. Une horreur. Quand elle tombe près de vous, elle provoque un effet de souffle terrible, qui vous déplace. Nous avons vu Manfred Schultz perdre sa main en tentant de renvoyer une de ces grenades, puis Michel Grandjean, transporté sur un brancard et tenant ce qu’il lui restait de jambe, le visage ravagé de douleur. C’était épouvantable, la guerre, au milieu de la pluie, du brouillard, de la fumée, des détonations. Il fallait qu’on s’en aille. Mais les policiers se sont préparés à charger, leurs fusils lanceurs de grenades sont passés en position horizontale : ils nous tiraient dessus ! Tout est parti en désordre, c’était la débandade, la panique. Chacun pour soi, il s’agissait de sauver sa peau.
Nous nous sommes élancés à travers les haies, sur un terrain abrupt, boueux, glissant, mon frère derrière moi. J’ai pris la suite d’un groupe, dans une pente où il fallait monter à quatre pattes. Le souffle d’une grenade tombée à deux mètres de moi m’a déplacé. C’est là que j’ai perdu Vital de vue, mais je ne me suis dit qu’il était passé avec d’autres, ailleurs. J’ai rejoint la voiture, je l’ai attendu. Les amis m’ont rejoint et, inquiets, nous sommes partis à sa recherche. Nous savions qu’il y avait beaucoup de blessés. Dans un des villages, nous avons été ralentis par un embouteillage : un policier fou furieux cassait les pare-brise de tous les véhicules qui passaient avec la crosse de son fusil. C’était d’une violence ! Quand notre tour est arrivé, ce flic s’est fait ceinturer par ses copains, il hurlait. Une personne m’a confirmé les rumeurs : oui, il y avait un mort et il s’appelait Viton François. Là, j’ai senti quelque chose de glacé me parcourir. »
Paul Michalon se rend alors à la mairie de Bouvesse, où il identifie le corps de Vital. Contrairement à ce qu’affirmera le préfet Jannin — un « décès suite à une crise cardiaque » —, l’autopsie conclura à une mort causée par « des lésions pulmonaires qui sont dues au souffle d’une explosion ». Sans se prononcer sur l’origine de celle-ci. Dans un rapport d’octobre 1979, un groupe d’experts exclura que le jeune enseignant ait pu être « victime de l’explosion d’une grenade OF 37 [offensive] explosant à moins d’un mètre de lui », et penchera pour une bombe artisanale lancée par un manifestant. Mais, pour Paul Michalon comme pour bien d’autres, l’hypothèse ne tient pas : le corps était intact, sans blessure ni impact, ce qui disqualifie les explosifs artisanaux de l’époque. « Vital a monté le chemin à quatre pattes, et la grenade est tombée devant lui, elle a roulé, et elle a éclaté entre le sol et lui, sous lui. L’effet de souffle lui a fait exploser les poumons. » À la suite de la plainte contre X déposée par les parents Michalon, le juge d’instruction rendra une ordonnance de non-lieu le 21 novembre 1980, faute de preuves concluantes.
« La mort de Vital m’a apporté de la vitalité »
Depuis, la famille Michalon — les six frères restants, les parents et les nombreux cousins — ont fait leur deuil. « Le jour des funérailles à Die [commune drômoise d’où était originaire Vital], nous avons fait poser six poignées sur le cercueil, pour le porter tous ensemble », sourit Paul Michalon. Tous les dix ans, ils se rendent sur la stèle, comme ce lundi 31 juillet 2017. « On se raconte des histoires sur lui, on se marre. »
« Je ne remercie personne, je m’en serais bien passé, mais cette mort nous a éclairé sur ce qui est essentiel, “vital”, estime Paul, âgé à l’époque de 22 ans, et devenu ensuite professeur d’histoire. Dans toute la famille, on retrouve ce désir de vivre une vie qui a du sens, qui fait avancer le monde, même si ça paraît un peu grandiloquent. La mort de Vital m’a apporté de la vitalité. » Cette énergie particulière, la famille désire aujourd’hui la partager avec d’autres : ils ont ainsi invité les proches de Rémi Fraisse — victime lui aussi de la violence de l’État — à la commémoration du lundi 31 juillet.
« Nous avons nos souvenirs, mais [l]a mémoire [de Vital] ne nous appartient plus », poursuit-il. Pour toute une génération d’écologistes, « la mort de Vital Michalon est très symbolique d’une situation dans laquelle a été créé un état de guerre, avec la volonté de tuer pour tuer la contestation », soutient Raymond Avrillier. Opération réussie pour les autorités : après le 31 juillet 1977, les protestations n’ont plus jamais été les mêmes, le mouvement antinucléaire a été totalement et durablement démobilisé.
Pour autant, nombre de manifestants présents à Creys-Malville ce 31 juillet 1977 ont poursuivi leur engagement, autrement. Ainsi, Raymond Avrillier a participé à la bataille juridique contre Superphénix au sein de la Frapna, notamment à la suite de la grave fuite de sodium survenue en 1984 (lire ci-dessous). Georges David a contribué pendant plusieurs années au journal Super Pholix, participant à l’information sur le surgénérateur. Il a ensuite géré l’une des premières centrales photovoltaïques de France. Yves François s’est intéressé de près à la méthanisation agricole et à l’agroécologie. Dans le cadre des liens tissés avec des opposants japonais au surgénérateur de Monju, il a même rencontré sa femme au Japon : elle est depuis venue s’installer à Creys.
SUPERPHÉNIX,
DOUZE ANS DE FIASCO
 |
|
Le redémarrage a été autorisé en janvier 1989. La même année, le réseau des Européens contre Superphénix s’est constitué, regroupant des dizaines d’associations et organisations de plusieurs pays européens, dont la France, la Suisse, l’Italie. Il deviendra en 1997 le réseau Sortir du nucléaire.
En 1990, la centrale a connu une nouvelle fuite de sodium ainsi que l’effondrement d’une partie du toit de la salle des turbines sous le poids d’une couche de de 80 cm de neige, alors que le réacteur était à nouveau arrêté. Le surgénérateur a redémarré au ralenti en 1994. Par décret, Superphénix est alors devenu un simple « laboratoire de recherche et de démonstration », la production d’électricité n’étant plus une priorité. Fin 1994 a eu lieu un quatrième incident majeur : une fuite d’argon (un gaz rare entourant le sodium liquide) à l’intérieur de la cuve du réacteur, qui a imposé une remise en état de sept mois.
En février 1997, alors que le surgénérateur était toujours à l’arrêt, le Conseil d’État a annulé le décret d’autorisation de redémarrage de Superphénix pris en 1994. Les associations ainsi que les villes de Genève et Lausanne ont ainsi obtenu, en droit, son arrêt.
Le 19 juin 1997, le Premier ministre, Lionel Jospin, a annoncé l’abandon de Superphénix. Un arrêté ministériel du 30 décembre 1998 conduisit à son arrêt définitif. La pression de l’opinion publique, le coût démesuré de la filière et l’accord signé entre les socialistes et les Verts ont poussé cette décision. D’après les calculs de Raymond Avrillier, au total l’installation n’a fonctionné que six mois durant les cinq premières années, deux ans durant les huit ans de son autorisation légale, et un peu plus d’un an, illégalement, de 1994 à 1997.
Depuis, des travaux de déconstruction ont été engagés, notamment le déchargement des 650 assemblages radioactifs présents dans le cœur du réacteur, et leur entreposage dans une piscine située à proximité de la centrale. Plus de 14 tonnes de plutonium irradié sont ainsi stockées à Creys-Malville. Les 5.500 tonnes de sodium liquide ont été transformées en 39.000 mètres cubes de blocs de béton-sodium légèrement radioactifs, également entreposés sur le site. Et le démantèlement pourrait encore prendre plusieurs années. Des gendarmes gardent en permanence l’ex-centrale, interdisant photos et arrêts prolongés devant le site.
Pour celles ou ceux qui souhaitent aller plus loin, voici trois extraits du journal Super Pholix paru en août 1977.
- Éditorial : https://reporterre.net/IMG/pdf/super_pholix_edito.pdf
- Un témoignage de la répression :
- Lettre de Michel Grandjean : https://reporterre.net/IMG/pdf/lettre_michel_grandjean_-_super_pholix.pdf
Reporterre remercie la famille Michalon pour son accueil et pour nous avoir transmis des photos de Vital.
« Rémi Fraisse et Vital Michalon
sont le symbole de la violence d’État »
- Le 31 juillet 1977, à Creys-Mépieu (Isère), une manifestation contre le projet Superphénix était brutalement réprimée. Vital Michalon, 31 ans, y a perdu la vie, une centaine de personnes ont été blessées. Paul, l’un des frères de Vital, explique le parallèle avec la mort de Rémi Fraisse à Sivens et dénonce « le maintien de l’ordre à la française ».
Paul Michalon est l’un des six frères de Vital Michalon. Présent aux côtés de son frère lors de la manifestation du 31 juillet 1977, il avait alors 22 ans. Professeur d’histoire-géographie récemment retraité, il vit aujourd’hui en Ardèche.
Reporterre — Ce lundi 31 juillet, la mère et la sœur de Rémi Fraisse seront à vos côtés pour commémorer la mort de Vital Michalon. Vos deux histoires se ressemblent tragiquement : c’est la même histoire qui se répète…
Paul Michalon - La mort de Rémi Fraisse nous a retournés, car c’était un copié-collé : un jeune homme tué par une grenade alors qu’il participait pacifiquement à une contestation contre un grand projet. Rémi, Vital, c’est l’impossibilité de se déclarer contre la raison d’État.
Le drame de Sivens a eu un écho très puissant dans notre famille, mais également au-delà. Je suis encore stupéfait de constater le nombre de gens qui ont intégré le nom de mon frère. Des personnes se rendent tous les ans sur la stèle à Faverges [sur la commune de Creys-Mépieu], tant ils ont été bouleversés. Sa mort est un événement historique national, notamment pour le mouvement antinucléaire. Il en va de même pour Rémi Fraisse. Ils sont le symbole de la violence d’État.
Nous avons fait le lien, les médias l’ont fait aussi. Il faut faire les liens avec tous les morts de la répression policière, avec Malik Oussekine, Adama Traoré. Lors de la manifestation du 19 mars pour la justice et la dignité, un de mes frères s’est rendu à la marche avec une photo de Vital. Les contextes sont différents mais les méthodes restent les mêmes : c’est l’art français du maintien de l’ordre.
Que voulez-vous dire ?
Il existe en France une conception militaire du maintien de l’ordre : les méthodes et le vocabulaire — encercler, tenir le terrain, repousser, riposter —, le matériel antiémeute, le regard sur le manifestant vu comme un ennemi de l’intérieur. Ce savoir-faire français vanté par Michèle Alliot-Marie auprès du régime de Ben Ali en 2011 en Tunisie nous vient de loin, et notamment de la guerre d’Algérie.
Arrêtons de voir toute manifestation citoyenne comme un combat guerrier ! Il faut des assises du maintien de l’ordre, des états généraux de la manifestation. Si on ne cherche pas collectivement d’autres manières de répondre à une contestation, on va vers de nouveaux drames. Il y aura d’autres Vital Michalon.
La violence d’État s’exprime particulièrement dans certains cas : dans les banlieues, sur les Zad, contre les antinucléaires…
Cette violence s’exprime quand il est question de la raison d’État. Le pouvoir se fixe des priorités, qui doivent l’emporter quoi qu’il en soit. Quels que puissent être les « dégâts collatéraux » ou les conséquences sur notre démocratie, elle doit prévaloir. L’aventure nucléaire est totalement dans cette lignée-là.
Le programme électronucléaire a été lancé sans consultation, sans concertation, sans débat contradictoire, et il s’accompagne systématiquement du mensonge : Creys-Malville, Tchernobyl… Les enjeux, les intérêts économiques, technologiques, militaires sont gigantesques. C’est pourquoi le nucléaire constitue un noyau potentiellement totalitaire et déjà partiellement totalitaire. Et si tu touches à ça, alors on te tire dessus...
Face à cette violence d’État, le mouvement écologiste et social n’a pas trouvé de moyens pour exprimer sa contestation sans se mettre en danger…
Oui, on est dans une impasse, les zadistes en font les frais aujourd’hui. Mais le mouvement écologiste n’est pas mort, même s’il est marginalisé. La contestation s’exprime autrement, via internet ou d’autres formes d’action. Et la préoccupation écologiste a très bien infusé dans la société : l’envie de vivre autrement a pris le pas sur la protestation classique.
Les citoyens sont beaucoup plus cultivés, ouverts et réfléchis que les politiques ne le croient. Nous sommes des millions à infléchir nos modes de vie, à changer. Les élus nous parlent encore de la ferme des « 1.000 vaches » et du nucléaire, ils sont dans le passé !
Entretien avec Paul Michalon - Propos recueillis par Lorène Lavocat - Reporterre










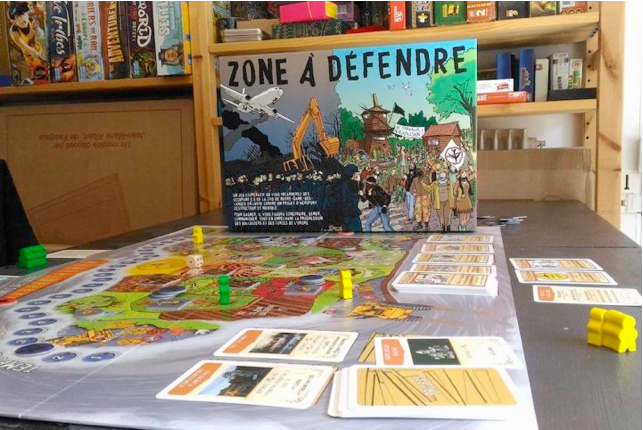







































































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire